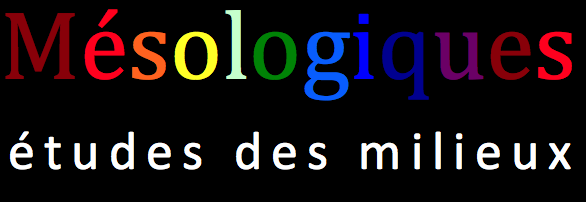Séminaire « Question de mésologie » (Paris, EHESS, le 26 mai 2011)
La socialité dans les déploiements urbains nippons.
Nature/culture : vers plus de droit ?
par Patricia Marmignon
Cette présentation fait suite à mes recherches antérieures synthétisées dans mon ouvrage paru fin 2010 : la création de l’urbain. Paysage urbain et socialité à Ôsaka depuis Meiji (1868). Vers une nouvelle socialité ? J’en suis arrivée au constat que la tendance en matière de socialité, dans le mode opératoire, est à une plus grande collaboration avec le privé et un urbanisme participatif, d’une part pour éponger les dettes gouvernementales, d’autre part, afin de renouer les liens sociaux. Et, cette orientation ne peut que s’affirmer face à la crise que connaît le Japon, depuis le séisme du 11 mars 2011.
Mes recherches, menées jusqu’à là, avaient mis en évidence le développement récent d’associations, de komyunitî, depuis la fin des années 1960, mais surtout depuis le séisme de Kôbe en 1995, dans un pays foncièrement communautaire, de type gemeinschaft, kyôdôtai, avec parallèlement un développement du droit juridique de plus en plus marqué, dans un pays où le droit coutumier, le droit naturel a prédominé. Ma question était alors, et demeure d’autant plus, d’appréhender véritablement cette tendance. Représenterait-elle un pas vers une reconnaissance du droit de l’individu, de l’urbain au Japon, dans les déploiements urbains ? C’est en ce sens que je vous livre cette présentation que j’ai intitulée : « La socialité dans les déploiements urbains nippons. Nature/culture:vers plus de droit ? » et qui a pour objectif de présenter les ressorts profonds de la culture japonaise, jusqu’au niveau des structures ontologiques, afin de mieux comprendre le milieu nippon dans son processus historique face aux évènements actuels, et à la reconstruction à venir du pays. Pour cela, je pars des fondements de la socialité nippone du début de Meiji (1868) jusqu’à la seconde guerre mondiale où ce pays, foncièrement coutumier de droit, développe alors une société de type gemeinscahft basé sur un droit naturel. Puis, je me penche sur le tournant que représente l’après 1945, mais surtout 1968 où l’on assiste au Japon à un embrayage entre droit naturel et droit juridique, à la suite des mouvements d’habitants, jûmin undô. J’en viens enfin, aux années 1990, notamment depuis le séisme de 1995, qui légifèrent et institutionnalisent cette tendance.
Mes recherches, menées jusqu’à là, avaient mis en évidence le développement récent d’associations, de komyunitî, depuis la fin des années 1960, mais surtout depuis le séisme de Kôbe en 1995, dans un pays foncièrement communautaire, de type gemeinschaft, kyôdôtai, avec parallèlement un développement du droit juridique de plus en plus marqué, dans un pays où le droit coutumier, le droit naturel a prédominé. Ma question était alors, et demeure d’autant plus, d’appréhender véritablement cette tendance. Représenterait-elle un pas vers une reconnaissance du droit de l’individu, de l’urbain au Japon, dans les déploiements urbains ? C’est en ce sens que je vous livre cette présentation que j’ai intitulée : « La socialité dans les déploiements urbains nippons. Nature/culture:vers plus de droit ? » et qui a pour objectif de présenter les ressorts profonds de la culture japonaise, jusqu’au niveau des structures ontologiques, afin de mieux comprendre le milieu nippon dans son processus historique face aux évènements actuels, et à la reconstruction à venir du pays. Pour cela, je pars des fondements de la socialité nippone du début de Meiji (1868) jusqu’à la seconde guerre mondiale où ce pays, foncièrement coutumier de droit, développe alors une société de type gemeinscahft basé sur un droit naturel. Puis, je me penche sur le tournant que représente l’après 1945, mais surtout 1968 où l’on assiste au Japon à un embrayage entre droit naturel et droit juridique, à la suite des mouvements d’habitants, jûmin undô. J’en viens enfin, aux années 1990, notamment depuis le séisme de 1995, qui légifèrent et institutionnalisent cette tendance.
Les fondements de la socialité nippone
Un droit coutumier
Un droit coutumier
Une analyse fine en sociologie structuraliste, dans une perspective diachronique, est fondamentale à l’entendement des ressorts profonds de la culture japonaise, car ceux-ci diffèrent fondamentalement des nôtres. En effet, par contraste au droit contractuel français, souvent lourd, qui repose sur le droit de l’individu, depuis le Code civil (loi 1804) dit Code Napoléon (1807), au japon, il s’agit essentiellement d’une collaboration basée sur une morale confucéenne, dans un système globalisant hiérarchisé. L’objectif est ici d’étudier la poétique de l’habiter au Japon et d’en dégager son sens respectif, dans son évolution. Dans cette
perspective, je présente ici cette communauté englobée dans ses fondements, de type kyôdôtai (gemeinschaft), reposant sur un droit coutumier.
Selon Kawamura Nozomu, dans Sociology and society (1994), pour Nishi Amane (1829-1897) qui introduisit la sociologie au Japon à la fin des années 1870, la société, de type gesellschaft (société locale), est étrangère au Japon traditionnel et moderne. Seule la société de type gemeinschaft (communauté, communauté englobante) où il y a interdépendance entre humains, ningen, a une résonance au Japon. Rappelons que cette distinction a été établie par Ferdinand Tönnies en 1887 dans Gemeinschaft und gesellshaft. Pour lui, la société de type gemeinschaft est établie sur l’identité substantielle des volontés assimilées, alors que la société de type gesellschaft est fondée sur la stricte individualité des intérêts. Or, la socialité japonaise est fondée sur un grégarisme holiste développé à partir des anciennes communautés rurales, mura, de type coercitif, ce qui correspond au type gemeinschaft (communauté) dans son principe global où les individus se fondent en une totalité par opposition à celle de type gesellschaft (société) où ce sont les intérêts personnels qui orientent les comportements. Je définis la socialité comme « la vie des hommes en société ou en communauté organisée selon une convention tacite dont la science étudie l’organisation et le développement » (Marmignon, 2010).
Le holisme, selon Dumont (Dumont, 1980 (1966)), procède du principe de « l’englobement du contraire » dans un système hiérarchique. Cette perspective holiste est englobante. Elle intègre les individus dans un système hiérarchique réflexif qui régit les rapports entre eux, entre les groupes, au contraire du système de stratification sociale étanche basé sur l’individualisme au nom de l’égalité et de la liberté. Or, la société japonaise est fondée justement sur la hiérarchie verticale, et sur la vertu d’humanité, elle est holiste et fait primer cette dimension à partir de communautés englobantes, kyôdôtai, regroupant l’ensemble du peuple nippon à travers la politique, l’économie et la religion (Marmignon, 2010). Cette orientation faisant dominer l’englobant sur l’englobé se retrouve à un degré plus ou moins fort dans différentes sociétés, comme en Grèce antique et au Japon, ou encore en Allemagne, en Russie et en Inde étudiées par Dumont. Durant l’Antiquité grecque, Platon (-428 ;-347) comme Aristote (-385 ;-322) entendaient l’homme avant tout comme un être social, et la polis englobait l’individu ou plutôt un groupe d’individus, les nobles, qui se devaient de pratiquer les mêmes cultes publics. Entre le divin et l’héroïque, tous les citoyens de la cité se trouvaient alors englobés. En Inde, « l’englobement du contraire » se fit par la religion à partir de la distinction entre le pur et l’impur, en Russie ce fut sur le domaine politico-social, et en Allemagne sur la vie intérieure, à travers la Bildung ou « éducation de soi ».
Au Japon, le tout intégrateur se fait avec le confucianisme et le néo-confucianisme, par les rites et la vertu d’humanité. Depuis Meiji (1868), le système englobant, part de l’empereur souverain déifié, et s’appuie sur l’ie (maison) issue de cette lignée, l’entreprise, ainsi que les communautés religieuses (Marmignon, 2010). Cette vision, globale et englobante, se retrouve dans la société à travers différentes communautés caractéristiques de la socialité nippone. Ces communautés englobantes intégrant les individus dans une vision holiste, sont les kyôdôtai. Il y a deux écritures à kyôdôtai. La plus courante utilise le préfixe 共同体 qui signifie « les deux, ensemble, partager ». Il est également utilisé comme abréviation du terme communisme (共産主義). L’autre écriture 協同体 signifie « coopérer, accord, harmoniser », il associe en clef, grouper, réunir au phonétique désignant les forces unies. Cette différentiation est importante. Si l’une insiste sur l’aspect commun, littéralement « une société commune », l’autre met l’accent sur une « collaboration établie au sein d’un même corps ». Selon le Nihon-shi dai jiten (1993), cette distinction se retrouve en allemand. Le terme gemeinschaft (共同体), traduit en anglais par community et en français par communauté, fait référence à un sentiment de dépendance mutuel. Alors que celui de gemeinde (協同体) insiste plus sur le lien social fondé sur la propriété foncière, terme usité en histoire économique. Il en est de même au Japon. Le Kôjien (2004) défini les kyôdôtai ainsi : « Kyôdôtai (community). Style de vie commun à des personnes liées à la base sentimentalement par des liens de sang ou de terre. Elles exercent entre elles un soutien et un contrôle mutuels. Elle est à distinguer de l’organisation qui est fondée pour accomplir un but particulier ».
Le holisme nippon se base sur un vitalisme propre à l’Orient qui ne sépare pas l’objet du sujet, la culture de la nature, l’individu du collectif, autrement dit, selon Augustin Berque (1986), qui induit un rapport trajectif entre l’homme et son environnement, entre l’être humain et son milieu social et paysager. Ce vitalisme de type holiste s’oppose au mécanicisme qui correspond à un réductionnisme. Il s’oppose au dualisme cartésien, à la distinction entre le sujet et l’objet. Dans ce holisme vitaliste, la structure de l’organisation et les niveaux sont importants ; les approches organicistes englobantes sont sous-jacentes ; la force vitale, principe de liaison, est le principe directeur de l’organisme. Ce rapport trajectif est de l’ordre de la liaison et non de la causalité comme cela peut l’être dans le naturalisme (Marmignon, 2010). Le naturalisme induit un rapport de causalité au contraire du vitalisme oriental. Il part également de l’inné comme détermination et néglige les facteurs environnementaux. Enfin, il est intrinsèquement occidental puisqu’il s’oppose et constitue une dualité avec le culturalisme qui fait prévaloir le conditionnement éducatif. Cet holisme vitaliste est manifeste à travers les rites qui ponctuent la vie des Japonais et demeure en toile de fond de la socialité nippone. Selon Ogyû Sorai (1666-1728), « Les rites, dans leur efficacité mécanique, ont une immense portée politique. Plus que les explications verbales, plus que les menaces de force, plus que les sanctions et l’administration, ils inculquent dans des populations, incapables d’en saisir la signification ultime, l’ordre de la voie. La voie est l’ordre des règles et des rites où tout se tient, où rien n’est de trop et où tout est cohérent (…) Sorai semble raisonner de façon circulaire, ou plus exactement holiste. » (Ansart, 1998). Ogyû Sorai est connu pour avoir rompu avec le néo-confucianisme en ayant introduit une césure entre le public et le privé, politisé le confucianisme, accordé une importance aux faits et aux mots, aux Saints, plus qu’au Li métaphysique (la Voie du Ciel) et donc pensé à une morale moins radicale (Maruyama, 1996 (1952)).
De manière générale, le confucianisme, doctrine philosophique et morale, présente dans la sphère politique et économique, forme une communauté à caractère holiste à travers les relations rituelles qu’il engendre entre les individus, fondées sur la vertu d’humanité. Rappelons le, comme le souligne Ansart (Ansart, 1998), l’ordre social est garanti dans le confucianisme par les vertus d’affections entre père et fils, de correction entre prince et sujet, de distinction entre époux, d’ordre entre aîné et cadet et enfin de sincérité entre amis. Et, il s’agit bien ici d’un englobement des contraires dans un rapport hiérarchique. Dans le paysage, la nature, les dieux et l’empereur sont ainsi toujours présents dans le quotidien des Japonais venant rythmer leur vie à travers les rites et les métaphores paysagères, les géogrammes. Et les bases de la socialité nippone sont instituées à partir de ces prises, tegakari, paysagères. Elles mènent à ce que Berque (2004) appelle « la grande confrérie nippone ». Ce procédé institue la suprême kyôdôtai (communauté, communauté englobante), l’uchi (intérieur clos hiérarchisé), le peuple japonais avec l’empereur, Tennô, à sa tête, lui-même descendant du couple de Kami primordial, créateur du pays.
Un droit naturel
C’est dans un pays de droit coutumier que Gustave-Émile Boissonade (1825-1910) introduisit le droit naturel dans les années 1880. Conseiller-juriste du ministère de la justice au Japon de 1873 à 1895, son Code pénal et son Code de procédure criminelle furent retenus, alors que son Code civil faisant primer le droit de l’individu fut rejeté au profit du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch). Le mode opératoire nippon dans l’urbanisation et l’industrialisation du pays est alors fondé sur une collaboration à partir d’une convention plus qu’un contrat. Durant la période moderne, se développent le familiarisme, kazoku-shugi, comme ramification de la grande confrérie nippone réaffirmée à partir de Meiji, l’État-nation ou l’État-famille, kazoku-kokka, en tant que kyôdôtai, et notamment les chônaikai (communauté de quartier) liées par l’habiter et l’habitat, produit de la modernité dont l’unité est l’ie 家, la maison. La réglementation en matière d’urbanisme n’est alors qu’embryonnaire.
Comme le dit Christian Sautter, dans L’État et l’individu au Japon (1990), « à la manière des maisons de bois qui grincent et plient sans se rompre lorsque passe le typhon ou que la terre tremble, la société pré-moderne japonaise était solidement charpentée. D’un côté la tradition confucéenne imposait à la personne les vertus d’obéissance, d’éducation et de labeur ; de l’autre, le principe de l’ie (la maison ou la maisonnée ; prononcer i-é) enfermait l’individu dans une cellule familiale élargie, soumise à l’autorité absolue d’un père qui transmettait ensuite ses biens et son pouvoir au fils aîné. La contrepartie de ce devoir de respect était un certain droit à la protection et à la bienveillance de la part du chef de famille. Si la restauration de Meiji rompit la hiérarchie des classes sociales (…) elle n’a pas brisée le noyau de l’ie. Au contraire, après les premières hésitations démocratiques, la structure de l’ie a été sublimée pour faire de l’Empereur le père absolu de la grande famille japonaise : les pyramides familiales se sont fondues dans une grande pyramide nationale ». « La culture japonaise prémeijienne, (Beillevaire, 1986) ne connaissait en effet que la notion d’obligation ou giri, véritable ciment de la société traditionnelle qui liait, de façon plus ou moins asymétrique, mais toujours durable, les individus entre eux. Il fut d’ailleurs nécessaire de recourir à un néologisme, kenri (droit) qui associe l’idée de pouvoir, ken, à celle d’intérêt, ri, pour rendre en japonais cette notion de droit empruntée à l’Occident. À l’évidence, il y avait là l’ébauche d’une philosophie sociale individualiste qui aurait pu mettre en péril les valeurs communautaires de loyauté et de piété filiale caractéristiques de la société japonaise traditionnelle. C’est pourquoi d’emblée, le discours conservateur et déjà prédominant tendra à interpréter la notion de droit, notamment pour la personne du chef de maison, comme un pouvoir, non pas inhérent à l’individu, mais délégué à ce dernier par l’État ». Sur ce thème, un texte est consacré dans l’ouvrage qui vient de paraître dirigé par Christian Galan et Emmanuel Lozerand, La famille japonaise moderne, 1868-1926 : Discours et débats, (2011).
Au préalable, à la restauration de Meiji, qui serait depuis 1945 plutôt à considérer comme une révolution, un courant démocratique était pourtant parvenu au Japon, notamment avec la traduction de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Constitution montagnarde de 1793 ainsi que des œuvres littéraires. Un des fondateurs de la littérature moderne au Japon est le romancier et essayiste Shimazaki Tôzon (1872-1943). Influencé par Zola, Tolstoï et Dostoïevski, il donna ses lettres de noblesse au naturalisme. La littérature naturaliste est liée aux pathologies sociales. Nakae Chômin (1847-1901) traduisit aussi en 1882 le Contrat social (Min-yaku yakkai) de Rousseau et de fait mit en avant le droit individuel. Nagai Kafû (1879-1959) découvrit Zola, le naturalisme et l’individualisme en 1902-1903. Mori Ôgai (1862-1922) fut aussi un des premiers à avoir témoigné d’une préoccupation réaliste. Il développa un naturalisme inspiré de Zola. Les œuvres de Natsume Sôseki (1867-1916) sont une apologie du naturalisme et de l’individualisme. Celles de Fukuzawa Yukichi (1835-1901), né à Ôsaka, ont constitué une réflexion philosophique basée sur une conscience individuelle. Et, c’est à cette époque que se développa le Mouvement pour la liberté et les droits du peuple. Sur ces thèmes, je rends hommage à Jean-Jacques Origas et renvoie à Emmanuel Lozerand pour leurs enseignements philologiques et littéraires à l’Inalco.
Gustave-Émile Boissonade (1825-1910), professeur de droit à la Faculté de droit de Paris, se voit à cette même époque, proposé, à la demande de Hisanobu Samejima, ministre du Japon à Paris, de se rendre au Japon pour moderniser et perfectionner le système juridique. Il fut ainsi conseiller juridique auprès du gouvernement japonais, du ministère de la justice de 1873 à 1895 où il participa activement à l’établissement des lois modernes comme à l’enseignement du droit. Il rédigea ainsi le Code pénal et le Code de procédure criminelle, qui après avoir été traduits en japonais et discutés au Sénat, furent promulgués en 1880 et mis en vigueur en 1882. Mais, le Code civil qu’il proposa en 1890, inspiré du Code Napoléon, fut rejeté, comme l’a montré Higuchi Yôichi (1994), parce qu’il portait atteinte à « l’esprit de loyauté envers le souverain (chû) et la piété filiale (kô) ». Aussi, il fut révisé en 1893 et retravaillé par des juristes japonais à partir du Code civil allemand, le Bürgerliches Gesetzbuch, laissant place à l’esprit communautaire qui servit de modèle. Précisons cependant, que si le Code civil de 1896, Minpô-ten, s’inspire de la législation allemande, une grande partie de la proposition de Gustave-Émile Boissonade fut conservée.
Celui-ci, en outre, est connu pour avoir introduit le droit naturel dans un pays où n’existait que le droit coutumier. Le droit naturel nous vient de l’École de Salamanque (début XVIe siècle) et ses concepts ont été repris par les théoriciens du contrat social (Hobbes, Locke, Rousseau). Le droit naturel est défini par Montesquieu (1995 (1748)) comme étant le droit qu’il s’agit de découvrir dans la parole divine, dans la nature des choses ou celles de l’homme. Selon Kant, les droits naturels, issus de la nature de l’homme, seraient le droit de propriété à partir de l’occupation, le droit personnel qui découle du contrat, qui est la rencontre idéale de plusieurs volontés et qui est l’œuvre libre des individus, et le droit familial qui permet la maîtrise du mari sur sa femme, du père sur ses enfants, du maître sur ses domestiques… Le droit naturel, qui se fonde sur la nature de l’homme, sur une morale plus que des codes, a été opposé au droit positif, dans le courant de Hans Kelsen (1881-1973), à l’époque du positivisme, système philosophique fondé par Auguste Comte (1798-1857), qui par opposition signifiait la règle édictée par l’autorité compétente et assignée à la contrainte juridique. En dehors du contexte positiviste assez radical et temporel, contextuel, il est cependant plus judicieux de parler de droit juridique plutôt que de droit positif, comme le montre Pierre Legendre (2009) dans ses écrits, en regard de l’histoire, en vue d’un certain passage de la métaphysique à la phénoménologie.
Le système politique japonais « prit alors la forme d’un État-propriétaire familial, fondé non pas sur la souveraineté populaire, mais sur la souveraineté de l’Empereur », selon Yamamuro Shinichi (1990). La Constitution de l’Empire du Japon de 1889 énonce ainsi en son article 1 que L’Empire du Japon est gouverné par un Empereur de la Dynastie unique de toute éternité, et en son article 3 que l’Empereur est sacré et inviolable. « Le Code civil de Meiji (Meiji minpô), ainsi qu’on le désigne de nos jours, en reconnaissant la maison ou ie comme sujet de droit, maintenait le point de vue traditionnel selon lequel celle-ci constituait l’élément premier et fondamental de la société japonaise. En conséquence, l’identité individuelle continuait d’être principalement définie par l’appartenance à une maison et par l’inscription sur un registre domestique appelé Koseki. Le code affirmait également la primauté morale du chef de maison, le koshu, sur tous les autres membres » (Beillevaire, 1986). L’Empereur, par ailleurs, « était décrit comme un père (kachô, « chef de maison ») guidant le peuple avec bienveillance, et chaque famille particulière comme un rameau issu de la maison impériale (désignée comme la maison fondatrice du peuple ou de la nation (kokumin sôka) (…L’on peut ainsi dire, comme le souligne Beillevaire que) le processus de modernisation du pays s’est doublé, au prix d’une transfiguration de l’histoire réelle, d’un traditionalisme idéologique dont le couple empereur-famille constitue le support essentiel ». Ce procédé institue la suprême kyôdôtai.
Dans les déploiements urbains, le jeu des acteurs est fondé usuellement sur une « collaboration » entre le public et le privé. La communauté civile, le privé, est constituée de regroupements d’entreprises détentrices de propriétés foncières. Et le procédé utilisé est la création de conseils, kyôgikai. Dans la « collaboration », la société civile initie et réalise en négociant avec le public, i.e. l’échelon municipal, responsable de l’urbanisme. Des avantages, certes, se dégagent de ce procédé. Ce travail en commun est porteur de fruits, une terre fertile pour l’innovation, et d’intérêt économique dans le partage des coûts qu’il engendre. Cependant il est aussi source de rapports complexes et sujet à conflits. Ainsi, l’on utilise le vocable fukugô-ka, parfois suivi de (koraborêshon) dans des textes d’urbanisme japonais, pour désigner la « collaboration » génératrice de projets urbains plutôt que kyôryoku,
« coopération » en tant que « forces unies » (Marmignon, 2010). Fukugô-ka désigne en effet, derrière la collaboration, le principe complexe et composé dans une combinaison ajustée, et se fait entre une « communauté civile » et la partie publique, en l’occurrence la municipalité. Pour déjouer la complexité des rapports « communautaires » en « coopération » (kyôryoku), voire avant tout dans la « collaboration » ou « combinaison » (fukugô-ka) avec le public, le Japon use plutôt que de lois préalablement établies, d’une entente élaborée, d’une « convention » (kyôtei) entre intéressés, entre la partie civile et la partie publique. Elle ne procède point d’un « contrat (keiyaku)» comme il est entendu dans la civilisation occidentale. Le Kôjien le définit d’ailleurs comme un acte de loi, ou encore comme le lien unissant les hommes à Dieu, leur sauveur, dans le christianisme, ce qui ne correspond point dans ces deux cas à la culture nippone.
La collaboration qui prend appui sur une convention est fondée sur une morale objective, une éthique reposant sur la famille, la propriété et la corporation comme dans la doctrine hégélienne (Hegel, 1940 (1820)) . Il s’agit d’une conception naturaliste du droit versus positiviste, mais issue d’un artifice et non plus de la nature, depuis la « découverte du politique » par Sorai (Maruyama, 1996 (1952)), d’une pensée débarrassée de contraintes morales et normatives radicales . Cette « convention » est basée sur le « Serment en cinq points » préconisant le développement de l’initiative et de la création des personnes civiles. Celui-ci s’appuie sur la genèse de la césure entre le public et le privé, développée par Sorai. Le domaine privé est libéré du public, mais le public reste placé avant le privé dans la mesure où c’est lui qui décide. En bout de chaîne, se trouvent les habitants, liés à cette grande famille par le développement des chônaikai (communauté de quartier ; Marmignon, 2011 (A)) au début de Meiji. Elles sont liées par l’habitat et l’habiter et un produit de la modernité dont l’unité est l’ie, la maison. Issues d’un système venu de Chine au 7e siècle (Bel, 1980), elles renaissent en 1889 avec l’instauration des circonscriptions scolaires. Puis, se voient renforcées après le séisme de 1923 avec l’apparition des procédés réglementaires des conseils, chôkai kiyaku yôryô, qui vont réguler les chô, les groupes de voisinage, pour la reconstruction, l’information, l’assistance et la sécurité. En 1935, avec les burakukai 部落会, les communautés de hameaux liées aux élections, en dessous des communes, elles représentent le bout de la chaîne du fascisme japonais. Et, en 1940, elles s’étatisent, avec en leur sein des tonarigumi 隣組, groupes de dix maisons. Elles sont cependant « abolies » en 1947, par la proclamation du quinzième article du décret de Potsdam, car anti-démocratiques.
L’on peut donc dire qu’avant la seconde guerre mondiale, le droit coutumier à partir des rites, puis aussi le droit naturel qui prend appui sur la nature de l’homme, sous l’égide d’un Empereur déifié, à travers un système pyramidal hiérarchisé faisait jurisprudence au Japon. C’est ainsi qu’en matière d’urbanisme également, la réglementation n’est restée qu’embryonnaire. Des premiers règlements (Marmignon, 2010, 2011 (B)) font leur apparition concernant des quartiers résidentiels réservés aux étrangers, et pour cause. Quelques arrêtés relatifs aux voies et non à l’habiter voient le jour. En 1886, un règlement sur les baraques en longueur, nagaya 長屋 est promulgué à Ôsaka et à Kanagawa, et en 1899, l’arrêté sur la révision des quartiers de Tokyo. L’urbanisme moderne naît, certes, avec la loi d’urbanisme, Toshikeikaku hô 都市計画法, introduisant le périmètre de planification, toshikeikaku kuiki 都市計画区域 et les zones d’affectations, yôto chiiki 用途地域, du code de construction, Shigai-chi kenchiku-butsu hô 市街地建築物法, tous deux de 1919. La loi, en outre, établit la ligne de construction du bâti suivant la loi Adickes prussienne de 1902 et légifère le remembrement foncier, matrice de l’urbanisme nippon. Le zonage est l’outil de base également. Mais, cette réglementation est permissive et rudimentaire. Elle n’aura que peu d’impact sur les déploiements urbains, aussi bien à l’échelle architecturale où un éclectisme prédomine à l’inverse de nos alignements haussmanniens ou de nos toits rouges, qu’en ce qui concerne le contrôle de l’étalement urbain. Et, si cet éclectisme, par ailleurs, démontre a contrario la présence d’une certaine démocratie participative au Japon, celle-ci est englobée dans un système identitaire, à travers les rites, les usages et le jeu interactionnel entre acteurs, le mode opératoire.
L’embrayage droit naturel/droit juridique
Selon Fukase Tadakazu (1990), « Sur le plan de la culture constitutionnelle, le Japon traverse à l’heure actuelle une phase de transition (je dirais depuis 1945, mais surtout à partir de 1968, et de manière accélérée depuis les années 1990). L’atmosphère culturelle traditionnelle du « régime de Tennô », que l’on peut qualifier de verticale, souple, émotionnelle et utilitaire, cède la place à un nouveau climat créé par les principes de la Constitution actuelle (1947), dont le caractère essentiel est d’être individualiste, horizontal, rationnellement rigide et respectueux des droits de l’homme. Dans cette situation culturelle transitoire, les juges remplissent en fait une fonction de sensibilisation aux droits de l’homme et un rôle de réformateurs de la culture constitutionnelle ». Cette période est ainsi marquée par une « révolution démocratique par le droit » comme le souligne Higuchi (1994). On passe à partir de 1968, à la suite des mouvements d’habitants, jûmin undô, à un développement de komyunitî (association) parallèlement aux anciennes chônaikai (communautés de quartier). D’un point de vue urbanistique, la législation se met en place parallèlement à un développement keynésien, un urbanisme administratif, planifié.
La déclaration de Potsdam de 1945 ouvre le Japon à une tendance démocratique et au respect des droits de l’homme. C’est à cette époque que le concept de jiyû (liberté), perçu jusqu’à lors « par les Japonais comme le droit de faire n’importe quoi à sa guise dans la vie privé » prend son sens moderne et constitutionnel de « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (Fukase, 1990). Ce changement est d’abord marqué par la nouvelle Constitution du Japon, promulguée le 3 novembre 1946 et mise en vigueur le 3 mai 1947, Nihon-koku-kempô qui a adopté les principes fondamentaux de la souveraineté populaire. Ainsi, en son article 1, on trouve cette fois-ci « L’Empereur est le symbole de l’Etat et de l’unité du peuple ; il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain ». La souveraineté du peuple, les droits de l’homme et la renonciation à la guerre sont les principaux attributs de la nouvelle constitution. Selon Higuchi (1994), la « véritable émancipation de l’individu » se fit avec la déclaration de Potsdam et les grandes réformes qui s’en suivirent, telle la réforme agraire, la promotion du syndicalisme et l’« émancipation » de la femme. En l’article 24 de la constitution, en ce qui concerne la famille, comme le souligne Beillevaire (1986), l’article prévoit, dans le respect de la dignité humaine, une complète égalité juridique entre hommes et femmes (…) la nouvelle constitution abolissait ainsi, en droit, l’ancien système familiale. (Et), le code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 1948, se conforme aux principes constitutionnels ». Alors que le Code civil de Meiji, Meiji minpô, procédait d’une réaffirmation de l’ie lié à la notion d’État-famille, Kazoku-kokka, le Code civil de 1947 abolit en effet l’ie « au profit des droits à la personne ».
Si au Moyen-Âge, la disparition des shôen (domaines) a recentré la socialité nippone sur le mura (village) et l’ie (maison), la réforme agraire de 1945, nô-chi kaikaku, abolissant l’ancien système de propriété foncière et obligeant à la cession des terres cultivées selon le modèle anglais, a participé à l’éclatement de la communauté. L’État procéda au rachat de ces terres cultivées par des personnes vivant en ville et non point à la campagne et de celles qui étaient affermées de plus d’un chô (99,17 ares). Ainsi, de vastes sites furent acquis qui permirent la construction de grands ensembles et des villes nouvelles où l’idée de village et de maison disparue.
Les communautés de type kyôdôtai générées par la réinterprétation de l’ie dans les chônaikai en milieu urbain s’affaiblirent également. Après la guerre, le rôle des chônaikai (communautés de quartier) diminua, limité à des problèmes de maintenance dans le voisinage et plus récemment dans l’aide aux personnes âgées. Selon Tahara (1985), les formes de socialité issues de l’ie ont par contre perduré véritablement après la guerre en milieu urbain au sein des entreprises. Le « familiarisme », keiei kazokushugi, qui avait été mis en avant dès le début du XXe siècle et qui allait de pair avec la volonté du gouvernement d’établir un État-famille, kazoku kokka, fut repris au sein du modèle japonais. La structure sociale interne pyramidale attenante à la famille composée de liens sociaux étroits et interdépendants fut reprise dans les zaibatsu entre les deux guerres. Et, après 1945, elle survit dans les entreprises, pour une part dans les keiretsu, dans le cadre des entreprises capitalistes et dans les PME. L’horizontalité se mêla alors à la verticalité mais les notions de groupe, de firme et de liens de sous-traitance évoquaient toujours l’ie. Le syndicalisme se développa aussi spectaculairement durant la haute croissance (1955-1973). Un travailleur sur trois était syndiqué contre un sur cinq aux Etats-Unis à la même époque. Durant cette période, le système d’emploi basé sur les « trois trésors », i.e. l’emploi à vie, shûshin-koyô, le salaire à l’ancienneté et le syndicalisme représentaient aussi une réinterprétation du système pyramidal de l’ie. L’on voit bien ici que la notion de ie liée à l’entreprise a été radicalement coupée de l’organisation sociale dans l’habitat.
Les grands développements que sont les danchi (grands ensembles) d’après-guerre et les villes nouvelles, nyû taun, à partir des années 1960 reflètent d’ailleurs l’éclatement de l’ie de cette période. Il ne fut plus question de construire ensemble mais de consommer. Miura Atsushi (conférences des 4 et 25/11/04 à l’EHESS) parle ainsi de « fast-fûdo » en ce qui concerne la périurbanisation. Il joue sur le double sens qui existe en japonais entre fast-food relatif à un mode de consommation rapide alimentaire et fast-« fûdo » relatif à la consommation rapide du « milieu » nippon avec les villes nouvelles et l’habitat diffus, ce qui n’est pas sans évoquer le McManshion américain. Avec l’urbain diffus, la priorité a été donnée à la circulation et non point à l’habiter, et l’ie a été désagrégée en ces lieux au profit d’un individualisme, d’une production et d’une consommation de masse, incarnés dans les années 1970 par les 3K : kuruma, kûrâ, karâ terebi (voiture, climatiseur, télévision couleur).
Cette époque se caractérise par un développement keynésien, une planification orchestrée par l’administration, un urbanisme planifié, toshi-zukuri 都市づくり, sans regard pour le milieu, et discrédité à partir des années 1970 (Marmignon, 2010, 2011 (B)). Le terme toshi-zukuri désigne l’urbanisme planifié, administratif, par opposition à machi-zukuri, urbanisme participatif, termes usités en ce sens depuis les années 1970. Celui de toshikeikaku, urbanisme, plus général, est aujourd’hui assimilé à celui de toshi-zukuri, ne laissant pas une place assez grande au machi-zukuri. C’est à partir d’une consultation, en 1968, que la formation de komyunitî コミュニテイー, i.e. des associations volontaires à partir de l’être social, voient le jour, et qu’un urbanisme participatif, machi-zukuri まちづくり, se développe autour de conseils, kyôgikai 協議会. Parallèlement, la nouvelle loi d’urbanisme, Shin-toshikeikaku 新都市計画, entame une décentralisation vers les départements et une libéralisation. Elle distingue les terrains urbanisables de ceux à contrôler, et porte sur la croissance urbaine. Par autorisation départementale, elle permet la conversion des terrains agricoles ou sylvicoles. La loi d’urbanisme de 1968 marqua un tournant dans le processus de décentralisation. Depuis la nouvelle Constitution du Japon de 1946, au profit des corps régionaux autonomes, chihô jichitai, la loi de 1947 sur l’autonomie des collectivités territoriales, Chihô jichi hô, une brèche fut ouverte vers une autonomie communale, et les pouvoirs locaux n’étaient plus censés être supervisés par le gouvernement central. Son amendement en 1956, donna naissance au système des villes désignées par ordonnance (au nombre de douze), seirei shitei toshi, qui se virent élargir leur pouvoir décisionnel en raison du nombre important de leurs industries et de leurs habitants, et notamment en urbanisme. Leur gestion administrative, leur organisation et finances n’étaient théoriquement plus supervisées, mais dans la pratique, ce fut l’époque de la planification administrative gouvernementale, toshi-zukuri, réalisée par le gouvernement central. Et, ce n’est qu’à compter de 1968 que l’on peut véritablement parler d’un tournant vers un droit juridique en matière urbanistique au Japon. En 1969, la loi sur la rénovation urbaine, toshi sai-kaihatsu hô, est promulguée à son tour et en 1969, le COS, dit « secteurs à capacité volumétrique », yôseki chiku est généralisé.
La collaboration avec le privé va reprendre également à compter de 1986, avec la détente entamée sous Nakasone à partir de la proclamation de la Minkatsu hô, la loi d’initiatives privées allant dans le sens de son slogan. Son appellation intégrale était Minkan jigyôsha no nôryoku no katsuyô ni yoru tokutei shisetsu no seibi no sokushin ni kan suru rinji sochi hô (Loi provisoire concernant l’accélération d’aménagements et d’établissements spéciaux par l’utilisation des compétences privées). Et, la participation des habitants se développa, non plus à partir de communautés englobées, mais par la mutation des fonctions des chônaikai et la création de komyunitî (associations) au tournant de 1968.
En premier lieu, c’est dans un esprit d’autonomie locale, que les chônaikai se développèrent après la guerre. Relancées officiellement par le traité de paix en 1952, qui rendait caduc le quinzième article du décret, les communautés de quartiers qui continuaient à œuvrer malgré tout à travers le pays, bien qu’amoindries par la destruction des quartiers, apportèrent dans un premier temps une assistance mutuelle entre habitants pour la reconstruction, les affaires de crime, d’hygiène ou encore l’orientation des jeunes. Elles étaient toujours un organe complémentaire au gouvernement, situées à la fin de la chaîne. Elles transmettaient, collaboraient et organisaient. Et, « dès 1953, 68% des villes du pays étaient dotées de tels groupes. À cette même date, le congrès des maires du pays demandait de rétablir ce système, comme institution, à tout le pays » (Bel, 1980).
Dans les années 1960, face aux saccages de la haute croissance, à l’industrialisation et à l’urbanisation rapide, une enquête fut menée par les municipalités auprès des habitants pour une réorganisation des communautés dont l’autonomie, jichi 自治, n’existait pas encore. Elles étaient sous le contrôle de l’État en tant que kyôdôtai, mais une brèche vers une démocratisation était apparue depuis la guerre. Et, de ce fait, des mouvements purent revendiquer une autonomie, pour une prise en considération des besoins locaux des habitants, et contre la pollution. Le mouvement national, kokumin undô 国民運動, mobilisa ouvriers et étudiants. Puis, les mouvements d’habitants, jûmin undô 住民運動, plus que des mouvements de citoyens, shimin undô 市民運動, se dressèrent contre le gouvernement local, puis central, la fédération économique et les sièges des milieux d’affaires. Souvent confondus aujourd’hui, c’est à cette époque, que l’on parla de jichikai 自治会, pour désigner les chônaikai.
L’approche communautaire fut alors revue, et la grande ville « reconnue », parallèlement aux discours sur le déclin du village. L’urbanisme en tant que société urbaine fut alors redéfini avec l’apparition du terme de komyunitî. Ce nouveau vocable fréquemment employé aujourd’hui, a été initié par le gouvernement pour répondre aux différents mouvements. Ce fait est important. Si les komyunitî sont apparues au Japon suite aux mouvements d’habitants, ce terme a été initié par le gouvernement qui a ainsi repris ce mouvement en un mouvement marchant avec le gouvernement et plus contre. Ce terme est, en effet, apparu pour la première fois dans un texte gouvernemental lors d’une consultation à une réunion d’enquêtes de l’assemblée délibérante sur la vie du peuple, auprès du Premier ministre Satô Eisaku, en janvier 1968 (Takemura, 1978). Au cours de cette réunion, la question de la formation de komyunitî (associations) fut examinée selon une problématique tripartite concernant la vie du peuple à long terme, les personnes âgées et les loisirs. Il n’était plus question d’une réinterprétation du mura en ville, mais d’associations au sens de MacIver (Marmignon, 2010).
Cette référence à MacIver a été soulignée par Wakamori Tarô, dans Nihon no kyôdôtai (1980 (1966)), à partir de son œuvre Community : A Sociological Study. Being an attempt to set out the nature and fundamental laws of social life, de 1917 où MacIver distingue les « communautés » des « associations » : la communauté est une aire de vie commune, contrôle, alors qu’une association demeure volontaire, mais à partir de l’être social (individuel et social), elle en est un organe. Dans l’association, ce qui prédomine, c’est « l’être social » dans un groupe organisé, construit dans un but, un intérêt commun.
Cette référence à MacIver est aussi présente dans le Kôjien, mais sa définition n’est pas aussi duelle que l’approche occidentale. Le Gendai yôgo no kiso chishiki (2006) nous dit que ces dernières sont basées sur « l’autonomie et la responsabilité des habitants ». De même, l’Imidas (2007) insiste sur le fait que ce sont les « habitants » qui en sont le « sujet principal ». La traduction adéquate, selon moi, de komyunitî est celle d’« association », plutôt que celle de « société » définie préalablement par Tönnies, car l’association part de l’« être social » (individuel et social), et non de l’individu. Elle est un organe de la communauté, et à une résonance moins duelle à l’oreille d’un Japonais comme me l’a souligné le Professeur Matsumoto Reiji (conférence du 3/02/10 à l’EHESS). Cette bivalence se retrouve chez Watsuji Tetsurô (1889-1960), notamment dans Fûdo (1935), traduit récemment par Augustin Berque (2011) et dans son œuvre majeure, Rinrigaku. (Ethics in Japan, 1996 (1937)). Cette ambivalence est fondamentale également dans la mésologie berquienne.
Note finale : vers un droit de l’individu ?
Se dirige-t-on vers plus de droit et une reconnaissance du droit de l’individu au Japon ? Certes, ce processus est entamé depuis 1945, mais surtout à partir de 1968 comme nous l’avons vu et magnifié depuis les années 1995, depuis le séisme de Hanshin-Awaji, dit communément séisme de Kôbe, et ne peut que s’accélérer dans cette direction avec la situation de crise actuelle que connaît le Japon depuis ce 11 mars 2011. C’est ainsi qu’en 1997, suite au séisme de Kôbe, la loi d’urbanisme et du code de construction furent modifiés concernant les quartiers résidentiels de grande hauteur, kôsô jîkyo yûdô chiku et la bonification du COS par la création d’espaces verts en guise de remplacement de la règle d’ensoleillement.
Depuis les années 1990, le Japon, afin de se reconstruire se réoriente vers une collaboration avec le privé, notamment avec l’amendement en 1999 de la Minkatsu hô, la loi d’initiatives privées (1986), pour utiliser les capitaux privés (Marmignon, 2010). Avec cet amendement, la Minkatsu hô ne mise plus seulement sur les compétences privées, mais également sur les capitaux privés pour financer la construction des équipements publics. Elle est devenue la Minkan shikinra no katsuyô ni yoru kôkyô shisetsura no seibira no sokushin ni kan suru hôritsu, la loi pour l’accélération des aménagements et établissements publics par l’utilisation de capitaux privés (PFI). Ce procédé a été utilisé en Angleterre lors de la réalisation de la ligne de chemin de fer des Docklands à Londres. Il est préconisé aujourd’hui pour la création de nouveaux équipements dans les développements périurbains existants, mais également en plein cœur urbain, par exemple dans l’opération de redéveloppement du quartier nord de la gare d’Ôsaka, mais aussi sur les côtes, les nouveaux terre-pleins.
Vont de pair, la loi sur la décentralisation de 1999, Chihô bunken ikkaku hô, lors de la réforme administrative de l’État en vigueur depuis 2001. On parla alors d’une autonomie du gouvernement local, dantai jichi, et d’une autonomie des habitants, jûmin jichi. Le gouvernement passa de 22 ministères à 12 et l’objectif fut une réduction de 25% des fonctionnaires sur dix ans. De nouvelles agences furent créées indépendantes du gouvernement, les IAI (Independant Administration Institution, Dokuritsu-gyôsei-hôjin) dans les domaines du territoire, des infrastructures et du transport, pour les musées, des écoles et instituts de recherches. En avril 2000, la nouvelle loi d’urbanisme qui accompagna la décentralisation donna tout pouvoir à l’assemblée délibérante des communes. Et désormais, il n’est plus nécessaire de passer par une délibération de l’assemblée représentative du territoire national, bien que demeure « la question du financement ». Sur ce dernier point, l’on peut se référer à l’ouvrage de Carola Hein et Philippe Pelletier, Cities, Autonomy, and Decentralization in Japan, notamment au texte d’Ishida Yorifusa (2006).
Le Japon mise aussi sur les collectivités locales et les habitants, avec le système de master plans (plans directeurs, globaux), les comités d’urbanisme intégrant les différents acteurs, et la loi NPO de 1998, qui reconnaît comme personnes morales ces nouveaux acteurs (Marmignon, 2011 (B)). La recherche s’oriente, aussi, sur une meilleure prise en compte des « corps intermédiaires », en référence à Montesquieu (1995 (1748)), comme me l’a indiqué le Professeur Matsumoto Reiji (conférence du 3/02/10 à l’EHESS). Les NPO ou Minkan hi-eiri soshiki, se développent ainsi de plus en plus ces dernières années pour répondre aux besoins qui diffèrent de ceux du gouvernement et des entreprises. Elles sont complémentaires et ne cessent d’augmenter depuis leur légifération. Pour donner une idée, de 85 en 1999 dans le département d’Ôsaka, elles furent multipliées par neuf en 2002, et passèrent à environ 740 NPO à la fin de 2002 (Michishita, 2003). En juillet 2003, 637 NPO avaient une activité dans la ville d’Ôsaka, concernant par ordre d’importance, l’aide à la gestion des groupes, l’éducation des enfants, l’éducation civique, la santé publique-l’hygiène et les soins médicaux, la collaboration internationale, la collaboration entre genre, l’urbanisme participatif, la préservation de l’environnement, la culture-l’art et le sport, la défense des droits de l’homme et au même titre, la sécurité locale et l’assistance en cas de désastre. L’urbanisme participatif rassemblait, en 2003, 7,2% des NPO de la ville d’Ôsaka.
Ce processus ascensionnel ne peut que s’accélérer aujourd’hui. Les komyunitî (associations) vont se multiplier notamment sous forme de NPO en sachant que des chônaikai ont été en partie détruites, et la législation va aller crescendo comme c’est le cas à la suite de chaque catastrophe. Je dirais en rendant hommage à Augustin Berque pour sa mésologie, que l’évolution au pays du soleil levant est à comprendre dans un rapport trajectif, de co-suscitation entre sa base, ses fondements, foncièrement communautaires, vers un certain droit de l’individu. Mais, qu’il faut bien avoir en tête qu’il ne s’agit point seulement d’une assomption, mais aussi d’une hypostase ou substantialisation, pas seulement d’une cosmisation, mais aussi d’une somatisation, et que l’esprit communautaire demeure en toile de fond au Japon. N’oublions pas que les komyunitî (associations), qui prennent en compte à la fois la part individuelle et la part sociale, ne sont que la reprise des mouvements d’habitants par le gouvernement. On peut ainsi imaginer la reprise des mouvements actuels par le gouvernement dans un avenir proche, mais dans une logique trajective de la concrescence en s’en référant à l’œuvre d’Augustin Berque. Je remercie M. Berque pour sa mésologie.
Références :
- ANSART Olivier. L’empire du rite. La pensée politique d’Ogyû Sorai. Japon 1666-1728. Genève/Paris : Droz,
1998, p. 78, p. 83, et p. 30.
- BEL Jean. L’espace dans la société urbaine japonaise. Paris : POF, 1980, pp. 134-135.
- BERQUE Augustin. Le sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature. Paris : Gallimard, 1986,
pp. 147-153.
- BERQUE Augustin avec SAUZET Maurice. Le sens de l’espace au Japon. Vivre, penser, bâtir. Paris :
Arguments, 2004, pp. 123-126.
- BEILLEVAIRE Patrick. « La famille, instrument et modèle de la nation japonaise », dans BULGUIÈRE André
et al., Histoire de la famille, vol.3 « Le choc des modernités ». Paris : Armand Colin, 1986, respectivement pp.
321-322, 318-319, pp. 331-332..
- DUMONT Louis. Homo Hierarchicus. Le système de castes et ses implications. Paris : Gallimard, 1980
(1966), p. 140.
- FUKAZE Tadakazu. « La Justice et la Liberté », dans HIGUCHI Yoichi et SAUTTER Christian, L’État et
l’individu au Japon. Paris : EHESS, 1990, respectivement p. 86 et p. 87.
- Gendai yôgo no kiso chishiki 現代用語の基礎知識 (Connaissances de base du vocabulaire contemporain).
Tôkyô 東京 : Jiyûkokuminsha 自由国民社, 2006, « Komyuniti コミュニテイ » p. 1567
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich (trad. par KAAN André). Principes de la philosophie du droit. Paris :
Gallimard, 1940 (Or.1820), 347 pages.
- HIGUCHI Yôichi. « Droit », dans BERQUE Augustin, Dictionnaire de la civilisation japonaise. Paris : Hazan,
1994, respectivement p. 150 et p. 151.
- Imidas. Saishin kîwâdo jiten イミダス・最新キーワード事典 (Imidas. L’Encyclopédie des mots-clés récents).
Tôkyô 東京 : Shûeisha 集英社, 2007, « komyunitî bizunesu コミュニテイービジネス » p. 653.
- ISHIDA Yorifusa. « Local initiatives and the decentralization of planning power in Japan », dans HEIN Carola
and PELLETIER Philippe, Cities, autonomy, and decentralization in Japan. London and New York :
Routledge, 2006, pp. 25-44.
- KAWAMURA Nozomu. Sociology and society of Japan. London : Kegan Paul International, 1994, 229 p. 40
et 5.
- Kôjien 広辞苑 (l’équivalent du Petit Robert français). Version électronique : Ex-Word. XD- R7200, Casio,
2004, « Komyunitî コミュニテイー » et « Kyôdôtai 共同体 ».
- LEGENDRE Pierre. Leçon IX. L’autre bible de l’Occident: le monument romano-canonique. Étude sur
l’architecture dogmatique des sociétés. Paris: Fayard, 2009, 536 pages.
- MACIVER Robert Morrison. Community, a sociological study. Being an attempt to set out the nature and
fundamental laws of social life. Lexington : Cornel University Library Digital Collections, 30 juin 2010
(1917), pp. 4, 22-23, 40 et 125.
- MARMIGNON Patricia. La création de l’urbain. Paysage urbain et socialité à Ôsaka depuis Meiji (1868).
Sarrebruck : EUE, 2010, 257 pages.
- MARMIGNON Patricia. « Chônaikai 町内会 (communauté de quartier) », via Internet :
HYPERLINK "http://ecoumene.blogspot.com/2011/03/chonaikai-communaute-de-quartier-par_02.html" http://ecoumene.blogspot.com/2011/03/chonaikai-communaute-de-quartier-par_02.html, CRJ de l’EHESS,
2/03/11 ((A) 28/01/11), 1 page.
- MARMIGNON Patricia. « Toshi hatten 都市発展 (développement urbain) », via Internet :
HYPERLINK "http://ecoumene.blogspot.com/2011/03/toshi-hatten-developpement-urbain-p.html" http://ecoumene.blogspot.com/2011/03/toshi-hatten-developpement-urbain-p.html, CRJ de l’EHESS, 31/03/11
((B) 3/03/11), 3 pages.
- MARUYAMA Masao (trad. par JOLY Jacques). Essais sur l’histoire de la pensée politique au Japon. Paris :
PUF, 1996 (Or.1952), pp. 112-147.
- MICHISHITA Katsuhiko 道下勝彦. « Ôsaka-shi ni okeru shimin kôeki katsudô to no kyôdô ni tsuite » 「大阪市
における市民公益活動との恊働について」 (À propos de la collaboration concernant les activités citoyennes d’intérêt
public dans la ville d’Ôsaka). Toshi mondai kenkyû 都市問題研究. Ôsaka 大阪 : Toshi mondai kenkyû kai 都市問題
研究会, octobre 2003, pp. 109-126.
- MONTESQUIEU. De l’Esprit des lois, I et II. Paris : Gallimard, 1995 (1748), respectivement 604 pages et pp.
851-889.
- Nihon-shi dai-jiten 日本史大事典 (La Grande encyclopédie de l’histoire du Japon), Tôkyô 東京, Kabushiki-
gaisha heibon-sha 株式会社平凡社, vol.2/7, 1993, « Kyôdôtai 共同体・協同体 » pp.818-820.
- SAUTTER Christian. « Présentation », dans HIGUCHI Yoichi et SAUTTER Christian, L’État et l’individu au
Japon. Paris : EHESS, 1990, p.16.
- TAHARA Otoyori. « Sur certaines formes de la socialité japonaise : le traditionnel et le contemporain- avec
quelques considérations sur les études sociologiques », dans BERQUE Augustin et SAUTTER Christian,
Sciences Sociales du Japon Contemporain. La socialité japonaise. N° 7. Paris : EHESS, mars1985, p. 19 à 45.
- TAKEMURA Yasuharu 竹村保治, «Ôsaka-shi no «komyuniti-zukuri» ni tsuite -kiroku to jakkan no kôsatsu» 大
阪市の「コミュニテイづくり」についてー記録と若干の考察— (À propos du développement des komyunitî dans la
ville d’Ôsaka. Actes et quelques observations), Toshi mondai kenkyû 都市問題研究. Ôsaka 大阪 : Toshi mondai
kenkyû kai 都市問題研究会, juillet 1978, p.78-79.
- TÖNNIES Ferdinand (trad. par HARRIS Jose et HOLLIS Margaret). Community and Civil Society
(Gemeinschaft und Gesellschaft : Grundbegriffe der reinen Sociologie). Cambridge : Cambridge University
Press, 2001 (Or.1887), 266 pages.
- WAKAMORI Tarô. Nihon no kyôdôtai (La communauté japonaise). Tôkyô : Kôbundô, vol.1, 1980 (1966), pp.
585-586.
- WATSUJI Tetsurô (trad. par BERQUE Augustin). Fûdo, le milieu humain. Paris : CNRS Éditions, 2011
(Or.1935), 330 pages.
- WATSUJI Tetsurô (trad. par YAMAMOTO Seisaku et CARTER Robert E.). Rinrigaku. Ethics in Japan. New
York : State University of New York Press, 1996 (Or.1937), 381 pages.
- YAMAMURO Shinichi. « Le concept de public-privé », dans HIGUCHI Yoichi et SAUTTER Christian,
L’État et l’individu au Japon. Paris : EHESS, 1990, p.27