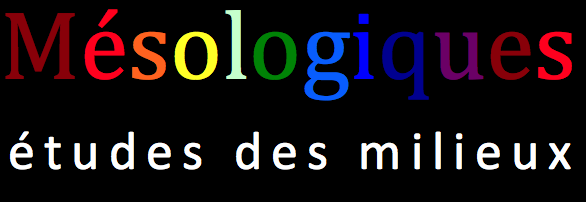|
| Paysage paradisiaque avec des animaux, Jan Breughel II (1613 - 1615) (source) |
Centro internazionale di studi interculturali di semiotica e morfologia. Università di Urbino, I giorni della biodiversità, 15 dicembre 2010
La biodiversité comme impératif moral
– de l’histoire naturelle à une histoire humaine –
par Augustin BERQUE
Résumé -
À partir d'une réflexion sur les analogies que présentent la théorie
des milieux humains chez WATSUJI Tetsurô et celle des milieux animaux
chez Jacob von UEXKÜLL, on présente l'hypothèse d'une contingence
exponentielle inhérente à l'histoire naturelle comme à l'histoire
humaine, et dont l'effet concret a été d’un côté une diversité toujours
plus grande (sauf extinction massive), tant des espèces vivantes que des
cultures humaines, et de l’autre côté une interrelation structurelle
entre l’existence de tout sujet (individu, société, espèce) et celle de
son milieu propre, ainsi chargé de toutes les valeurs existentielles de
ce sujet ; en particulier, pour l’humain, de ses valeurs morales. Le
mécanicisme du paradigme occidental moderne-classique a engendré une
tendance inverse, toujours plus accentuée, qui aujourd'hui atteint
l'allure d'une extinction massive sous ces deux aspects : d’un côté,
ravage de la diversité des espèces vivantes et des cultures humaines ;
de l’autre, neutralisation de toutes les valeurs au nom d’un
objectivisme qui n’est, en fait, qu’une forclusion de la moitié de
l’être (sa part existentielle). On se livre à quelques spéculations
quant aux raisons de cette tendance et à la possibilité de la renverser
pour retrouver le fil de la nature et de l'histoire, donc de la
diversité, ce qui de ce point de vue est un impératif moral.
1. Les impasses de l’objectivisme scientifique
On défend
habituellement la biodiversité pour des raisons écologiques et/ou
d’éthique environnementale. Les raisons proprement écologiques se
ramènent à l’idée que la biodiversité étant inhérente à la biosphère, la
réduire est nuire à l’équilibre de celle-ci, donc risquer des
dérèglements dangereux pour les espèces subsistantes, en particulier la
nôtre. Les raisons d’éthique environnementale sont plus complexes. On
peut, d’un côté, centrer la question sur les intérêts humains, par
exemple en évaluant les services rendus par les écosystèmes dans
l’économie, ou leur valeur culturelle, esthétique, patrimoniale etc. On
peut, d’un autre côté, centrer la question sur la biosphère en tant que
telle, en rejetant le « spécisme » anthropocentrique. Les variantes de
ce point de vue sont nombreuses ; on plaidera par exemple pour un
biocentrisme (où l’accent est mis sur la valeur du vivant en tant que
tel), pour un écocentrisme (où l’accent est mis sur les systèmes
relationnels qui soutiennent le vivant), pour un holisme (réduisant
l’écoumène – la relation de l’humanité avec la Terre – à la biosphère
qui la sous-tend), pour une « écologie profonde » (subordonnant l’humain
au grand « soi » de la nature), etc.
Toutes
les raisons susdites (y compris celles de l’écologie profonde) sont
sous-tendues par le dualisme du paradigme occidental moderne classique
(ci-après POMC), dont l’essentiel aura été, corrélativement, de faire de
l’environnement un objet, d’une part, et de l’autre d’auto-instituer le
sujet individuel. Ce dualisme a permis l’essor moderne des sciences de
la nature, dont fait partie l’écologie. Si l’écologie profonde,
contrairement à ce qu’elle présume, relève de ce dualisme, c’est qu’elle
dérive en fait de cette science moderne qu’est l’écologie. Dérivant de
cette science objective, son ontologie n’est qu’une ontologie des
écosystèmes, c’est-à-dire une ontologie de l’objet, incapable comme
telle de prendre en compte la subjectité de l’existence humaine.
Le même
reproche vaut peu ou prou pour la majorité des thèses de l’éthique
environnementale. Or cette incapacité structurelle de prendre en compte
la subjectité humaine engendre une série d’apories. En effet, l’on ne
peut pas dériver les valeurs morales d’une ontologie de l’objet. L’objet
en soi est neutre. Il n’a de valeur qu’en fonction d’un sujet,
c’est-à-dire uniquement s’il cesse d’être un objet pour devenir une chose,
concrètement liée à l’existence d’un sujet. C’est pourquoi, toutes
variantes confondues (holisme, biocentrisme, écocentrisme, écologie
profonde…), si l’on examine les articulations logiques de la
réduction de l’écoumène à la biosphère, c’est-à-dire de la projection
d’une science de l’objet (l’écologie) sur la morale, on se rend vite
compte qu’elle est farcie de contradictions, découlant nécessairement du
fait qu’elle dégrade l’humain au rang de simple vivant :
« Il y a
donc, au cœur du holisme écologique, une contradiction essentielle. Il
est bien, à la fois, incohérent et immoral. Immoral parce qu’il implique
la dévalorisation (voire la suppression) de l’être humain au rang de
non-sujet ; absurde parce qu’il implique en même temps que l’être humain
assume en tant que sujet cette dévalorisation, et se charge de la
mettre en œuvre. De nouveau immoral, puisque cela implique aussi que
certains êtres humains appliquent cette dévalorisation aux autres êtres
humains (par exemple, que 10% de l’humanité suppriment les 90%
surnuméraires). De nouveau absurde, parce que s’il veut éviter cette
immorale sélection entre les êtres humains, il doit attendre que la
nature la fasse toute seule (par exemple en laissant agir librement le
virus du sida sur les populations africaines) ; c’est-à-dire, en fin de
compte, qu’il ne doit rien faire… sinon agir responsablement, donc en
tant que sujet humain, pour améliorer la situation ! »
(Berque 1996, p. 79 sq)
Le
dualisme moderne, qui absolutise l'objet, ne permet effectivement pas de
fonder une morale dans la connaissance écologique de la nature ; car se
bornant à juxtaposer l'objectif au subjectif, il ne peut envisager
qu'une projection arbitraire (et non point naturelle) des raisons du
sujet humain, dont la morale, sur cet objet qu’est pour lui la nature.
Cette arbitrarité est explicite dans la théorie saussurienne du langage,
et conséquemment dans la doxa des sciences humaines contemporaines.
Elle traduit l’absolutisation du sujet qui est la contrepartie
symétrique de celle de l’objet. En termes logiques, cela équivaut à
découpler radicalement le sujet (S, le sujet du logicien, i.e. l’objet
du physicien) de tout prédicat (P, i.e. les termes dans lesquels un
existant humain ou non saisit S). Dans la formule idéale du dualisme, S =
R ; c’est le Réel pur, l'en-soi absolu, débarrassé de toute
interférence de P, i.e. sans rapport avec l'existence humaine, et donc
sans rapport avec la morale.
2. Les impasses du subjectivisme mystique
Dans le
domaine qui nous occupe – la crise environnementale de notre
civilisation – les réactions à l’encontre du dualisme moderne ont été
multiples. On peut les regrouper sous le nom de holisme, c’est-à-dire
une idéologie subsumant tant le sujet que l’objet sous la grande unité
d’un Tout. La divinisation de Gaïa par certains enthousiastes des thèses
de Lovelock en est un bon exemple. Dans cet exemple, une hypothèse
biogéochimique devient une mystique. De même, dans le New Age, la
connaissance des écosystèmes devient une communication subtile avec les
devas de la nature.
En
pareil domaine, les apports de la science nourrissent le mysticisme,
c’est-à-dire l’inverse de la science. Faisons ici l’hypothèse que la
cause de cette inversion n’est autre que le parti ontologique du
dualisme lui-même. C’est ce que va nous montrer l’aventure
intellectuelle du « dépassement de la modernité » (kindai no chôkoku 近代の超克) dans le Japon de la première moitié du XXe siècle.
Les
racines du dualisme moderne sont aussi lointaines que le choix
parménidien de privilégier l’être par rapport au devenir. Ce parti a
entraîné d’un côté l’ontologie platonicienne (où l’être est un absolu
dont l’existant – la genesis – n’est qu’une image imparfaite), de l’autre la logique aristotélicienne de l’identité du sujet (l’hupokeimenon), assimilé à la substance (l’hupostasis de l’ousia).
Aussi bien, lorsque la philosophie japonaise du XXe
siècle, dans l’école de Kyôto, a entrepris de dépasser le dualisme du
POMC, s’est-elle attaquée centralement à la logique de l’identité du
sujet. Tel a été le sens de la « logique du prédicat » (jutsugo no ronri 述
語の論理) mise en avant par Nishida. À l’inverse du POMC, qui absolutise
l’objet du physicien (i.e. le sujet aristotélicien, S), celle-ci
absolutise P, censé « engloutir » (botsunyû 没入) i.e. nier S (autrement dit l'être, u 有) dans un « néant relatif » (sôtai mu 相対無), jusqu'à se nier soi-même dans le « néant absolu » (zettai mu 絶対無). Se niant lui-même, le néant absolu engendre l’être.
Or le
saut de la négation de S par P à la négation de P par P est purement
illogique (logiquement, il ne peut y avoir là qu'une régression de
l’être à l'infini). Ce saut illogique n'est autre que celui de la foi,
que Tertullien posa explicitement avec son Credo quia absurdum.
Il équivaut à la formule P = R, qui est quasi à la lettre exprimée par
les premiers mots de l'évangile selon saint Jean : la Parole (P), c'est
Dieu, la substance absolue (R). Dans le cas de Nishida, cette mystique
s’est exprimée par l’assimilation de l’empereur au néant absolu, i.e. à
la source de l’être. Cette thèse ultranationaliste, comme toute
mystique, se ramène à la subjectivité ; en l’occurrence, à la
subjectivité collective de l’ethnocentrisme nippon.
Or on
voit que la formule P = R est l’énantiomère (l’inverse spéculaire) de la
formule R = S. Effectivement, la logique du prédicat sous-tend un
mysticisme inverse au matérialisme moderne, qui, lui, est sous-tendu par
la logique du sujet ; et elle est tout aussi incapable de fonder la
morale. Elle ne peut en effet que l'affirmer pour elle-même, dans le
raisonnement circulaire qu'illustre la notion de « sans-base » (mukitei
無基底
) chez
Nishida. Or fonder un système de propositions (ici la morale) en
lui-même est impossible, comme l’ont démontré les théorèmes de Gödel. On
ne peut pas fonder la morale pour des raisons morales.
Ainsi,
tant le dualisme que le holisme (la négation du dualisme), c’est-à-dire
tant la logique du sujet que la logique du prédicat, sont incapables de
fonder les raisons pour lesquelles nous serions tenus moralement de
respecter la nature, en l’occurrence la biodiversité. Il nous faut une
autre logique.
3. La réalité des milieux
Cette
logique dépassant les deux logiques susdites est celle du mouvement qui,
dans la réalité, unit les deux pôles du dualisme. Reliant ces deux
pôles, elle se situe dans leur entre-deux ; c’est une mésologique, une logique du milieu. De fait, elle repose sur l’étude des milieux : la mésologie.
Le terme
« mésologie », entendu comme l’étude positiviste des milieux, a été
créé par le médecin et naturaliste Charles-Philippe Robin (1821-1885).
Il l’employa dans son exposé inaugural lors de la fondation de la
Société de biologie, le 7 juin 1848. Ce terme fut repris et développé
par son confrère médecin, statisticien et démographe Louis-Adolphe
Bertillon (1821-1883), chez lequel il s’agissait, en somme, du champ
qu’allaient couvrir, respectivement, l’écologie et la sociologie.
Ecartelée entre ces deux versants, la mésologie a cependant fait long
feu.
Or ce
terme gagnerait à être repris, parce qu’il porte en germe la possibilité
d’exploiter une distinction fondamentale : celle qu’Uexküll a établie
entre Umgebung et Umwelt. L’Umgebung, c’est l’environnement brut, le donné objectif et universel valable a priori pour tout être vivant. L’Umwelt,
c’est le monde ambiant, le milieu qui existe concrètement pour le
vivant, non pour l’observateur scientifique. Ce milieu est fonction de
l’espèce ; aucune n’a la même Umwelt qu’une autre espèce, bien que toutes vivent dans la même Umgebung.
C’est dire que le milieu n’est pas l’environnement. Le milieu est constitué de choses pleines de sens et de valeur pour le sujet, alors que l’environnement est constitué d’objets, ces purs en-soi que prend en compte la science en s’abstrayant de toute subjectivité (en principe).
Corrélativement, la mésologie n’est pas l’écologie. Elle comprend
nécessairement une dimension herméneutique étrangère à l’écologie. Cette
dimension herméneutique a été mise en lumière par Watsuji, qui a
corrélativement établi, entre environnement (kankyô
環境
) et milieu (fûdo
風土
), une distinction exactement homologue à celle que, vers le même moment, Uexküll établissait entre Umgebung et Umwelt.
C’est
là, peut-on dire, une probation en double aveugle, car non seulement les
deux auteurs ne se connaissaient pas, mais Watsuji ne s’occupait que
des milieux humains, tandis qu’Uexküll s’occupait du vivant en général
(comprenant donc en principe l’humain, mais centré en fait sur
l’animal). On peut donc dire que la distinction kankyô / fûdo vaut pour l’écoumène, et la distinction Umgebung / Umwelt pour la biosphère, qui sous-tend l’écoumène.
Environnement abstrait, milieu concret
la condition abstraite
de l’objet
(le Réel)
|
la condition concrète
de la chose
(la réalité)
|
|
selon Watsuji, au niveau
ontologique de l’humain dans l’écoumène
et dans l’histoire
|
shizen kankyô :
l’environnement naturel
|
fûdo :
le milieu humain
|
selon Uexküll, au niveau ontologique du vivant dans la biosphère
et dans l’évolution
|
Umgebung :
l’environnement
comme donné objectif
|
Umwelt :
le milieu
comme monde ambiant
|
4. La trajection de la réalité
Or le fait
que cette double distinction se retrouve aussi bien dans l’écoumène que
dans la biosphère interdit de l’assimiler au dualisme sujet-objet, ou
culture-nature. Le fait que, dans un milieu humain, une longueur d’onde
électromagnétique de 700 nanomètres soit perçue comme rouge, alors
qu’elle ne l’est pas dans un milieu bovin, cela ne relève pas de la
subjectivité, mais de la réalité. Cela ne relève pas davantage de
l’universalité objectale de la physique, où il s’agit de la même
longueur d’onde dans les deux cas.
De tels
faits outrepassent la logique de l’identité du sujet, puisque le même
objet λ = 700 nm peut à la fois être et ne pas être rouge. Plus
exactement, suivant le milieu concerné, il peut à la fois exister en tant que rouge ou que non-rouge. La longueur d’onde λ = 700 nm est une affaire d’environnement, ou d’Umgebung ; tandis que la couleur rouge est une affaire de milieu, ou d’Umwelt.
Les
affaires de milieu supposent nécessairement l’interprétation de l’objet
(S) par un existant. Ce rapport est analogue à celui entre sujet et
prédicat en logique. La réalité des milieux réside justement dans ce
rapport. On peut l’exprimer par la formule r = S/P ; ce qui se lit : la réalité, c’est le sujet S en tant que prédicat P. Par exemple, c’est le sujet
< λ =
700 nm > (S) en tant que < couleur rouge > (P). Plus
généralement, c’est l’environnement en tant que milieu, ou l’Umgebung en tant qu’Umwelt.
On
voit que ce rapport ne peut pas être non plus réduit à la logique du
prédicat (où le prédicat « engloutit » son sujet), puisque la
prédication de S en tant que P suppose nécessairement S. Dans la
réalité, à la fois logiquement, ontologiquement et historiquement, S
précède P, qui ne peut pas le subsumer. Les ondes électromagnétiques
précèdent leur interprétation par le vivant, l’environnement précède le
milieu.
Cette
réalité des milieux, qui ne se réduit ni à l’objet ni au sujet
existentiel, ni au sujet logique ni à son prédicat, mais à leur
relation, elle relève de ce « troisième et autre genre » (triton allo genos) que Platon, dans le Timée, reconnaît à la chôra – le milieu existentiel de l’être relatif (la genesis), qui de celui-ci est à la fois l’empreinte (ekmageion) et la matrice (mêtêr, tithênê). Ni subjective ni objective, mais allant et venant de l’un à l’autre pôle, elle est trajective. Ces deux pôles, le subjectif et l’objectif, sont des abstractions ; la réalité concrète, elle, est trajective.
5. De l’histoire naturelle aux valeurs humaines
La
trajection de S en P (qui fait de l’environnement un milieu) est
éminemment dynamique. Elle est vivante. Elle cesse en effet à la mort de
l’être qu’elle suppose : une fois mort, celui se décompose, et lui-même
avec son milieu, conjointement, retournent à l’environnement. Le rouge
n’est plus que λ = 700 nm, l’Umwelt n’est plus que l’Umgebung.
Cependant, il faut ici distinguer soigneusement les échelles
spatio-temporelles de l’être. Si le Dasein heideggérien est « être vers
la mort » (Sein zum Tode), en ce sens que son monde cesse
d’exister à la fin de sa propre existence, c’est que cet Européen
moderne qu’était Heidegger (malgré qu’il en eût !) ne voyait les choses
que du point de vue de l’individu, comme le lui reprocha Watsuji. Pour
celui-ci, du point de vue de la société, l’existence est au contraire
« être vers la vie » (sei e no sonzai 生への存在), puisqu’elle se poursuit au delà des morts individuelles. On peut ajouter que l’espèce humaine, a fortiori,
se poursuit au delà de la disparition des sociétés, comme en
définitive, sauf cataclysme cosmique, la vie se poursuit au delà de la
disparition des espèces.
Si la
vie se poursuit au delà de la mort des sujets de toute échelle
spatio-temporelle et à tout niveau ontologique (personne, société,
espèce…), en revanche, elle-même n’existe concrètement qu’instanciée
dans chacun de ces sujets, à toute échelle et à chacun de ses niveaux
ontologiques. Par exemple, dans la vie de l’individu Pierre ou Paul, ce
qui vit n’est pas seulement une personne mais aussi une société
francophone, l’espèce Homo sapiens, l’ordre des Primates, et
ainsi de suite jusqu’à la vie en général ; et tout cela se tient dans
une seule et même réalité. Il est donc impossible de subsumer la valeur
du sujet Pierre ou Paul sous la valeur de la vie en général. Il n’y a
pas là de hiérarchie, mais une seule et même manifestation de l’être.
On peut
dire en ce sens que chaque sujet, conjointement avec son milieu, est
investi de la totalité de la valeur de la vie ; car cette réalité de
l’être, qui s’instancie dans Pierre ou Paul, est une singularité. Il n’y
pas, il n’y a pas eu et il n’y aura jamais deux Pierre ou deux Paul
absolument identiques. Chaque instance est totalement qualitative,
irréductible à la quantité.
Or cette
singularité purement qualitative, c’est aussi non seulement celle de
l’être à chacun de ses niveaux ontologiques (la personne, la société,
l’espèce etc.), mais encore celle de son milieu, également à tous les
niveaux ontologiques et à toutes les échelles spatio-temporelles ; car
dans l’histoire humaine comme dans l’histoire naturelle, il y a, par
l’effet de la trajection, co-suscitation entre le sujet et son milieu.
Nous
avons ici fondamentalement la raison pour laquelle nous sommes tenus
moralement de respecter la biodiversité, en même temps que les milieux
propres à chaque espèce. En effet, qu’il s’agisse de la biosphère
(l’ensemble des milieux vivants) ou de l’écoumène (l’ensemble des
milieux humains), que l’on soit à l’échelle de l’individu ou à celle de
l’espèce, c’est exactement le même principe de trajection qui a institué
la réalité des choses (S/P) ; c’est-à-dire, en fonction d’un existant,
la qualification d’un sujet universel S (l’environnement, l’Umgebung), par un prédicat contingent et singulier P, en un milieu S/P ( l’Umwelt
propre à l’existant en question). De même qu’un être humain a un nom
propre, qui le prédique en une certaine personne, en principe unique et
de ce fait d’une valeur morale infinie, de même, quel que soit son
niveau ou son échelle dans l’être, tout être vivant a son propre milieu,
en principe unique et, pour la même raison, d’une valeur morale
infinie.
6. De la forclusion des autres mondes à leur assomption morale
Mais
alors, tuer une puce ou exterminer une espèce de criquets serait-il
aussi grave que tuer un être humain ? Non, parce que nous ne pouvons
pas, ni en pratique ni en principe, sortir de notre propre milieu, dont
l’existence est ipso facto une forclusion de celui des autres vivants. Nous ne pouvons pas ne pas privilégier notre monde, lequel,
du fait
même que c’est le nôtre, est investi d’une valeur suprême. C’est bien la
raison pour laquelle (même s’il ne l’invoque pas encore, plus de deux
millénaires avant Uexküll !), dans les dernières lignes du Timée, Platon
qualifie le kosmos de megistos kai aristos kallistos te kai teleôtatos
(très grand, très bon, très beau et très parfait). Il y a là une
nécessité ontologique et biologique à la fois : aucun autre monde ne
pourrait être le nôtre. Seul le nôtre nous convient, les autres mondes
nous sont impropres. Nous ne pouvons que les forclore (foris claudere : lock them out).
Cette
forclusion explique que, pendant longtemps, et spécialement dans la
tradition judéo-chrétienne (les choses sont bien différentes dans le
bouddhisme, par exemple), l’humanité ne se soit guère souciée de morale à
propos des autres espèces. L’éthique humaine restait centrée sur son
propre monde : cosmocentrée, i.e. anthropocentrée. Puis le développement
de ce point de vue de nulle part qu’est la science moderne, petit à
petit, nous a décentrés au point de reconnaître que chaque espèce
vivante a son propre ethos et son propre milieu, qui pour elle est non
moins suprêmement qualitatif que le kosmos l’est pour Platon. Au
point où nous en sommes, comme en témoigne l’essor de l’éthique
environnementale, nous ne pouvons plus nous dispenser de reconnaître
cette valeur, et d’en tirer la conclusion que nous devons respecter
toutes les espèces vivantes, donc la biodiversité.
Ainsi,
la science moderne aura eu cet effet paradoxal que, dans un premier
temps, elle a dévalorisé radicalement la nature en la transformant en
objet, puis, dans un second temps, et du fait même de cette
objectification, elle l’a revalorisée au nom des réalités qu’elle nous a
permis de découvrir ; par exemple, dernièrement, que les grands singes
ont un certain sens moral.
Toutefois, nous sommes encore loin d’avoir renversé le cours de la
civilisation dont le développement fut entraîné et déterminé par le
mécanicisme du POMC. Cette civilisation reste gouvernée par l’idéal de
la machine, qui est l’incarnation parfaite du principe de l’identité du
sujet : la répétition indéfinie du même (comme dans un moteur à
piston), alors que l’essence du vivant est, à l’inverse, que le même y
suppose toujours l’autre, aussi bien dans son propre changement (il
naît, croît, dépérit et meurt) que dans le fait que son existence est
indissociable de son milieu (ce qui comprend les autres vivants) ; et
réciproquement : son milieu est indissociable de sa propre existence.
Cette nécessité de l’autre
serait déjà une bonne raison de respecter la biodiversité, mais il y a
plus. Dès avant l’apparition de la vie, la flèche du temps a orienté
l’univers en une suite d’émergences qui, contrairement à l’itération
mécanique, ne sont ni répétables, ni réversibles. Elles sont
contingentes. Avec la vie, et a fortiori avec l’humain, cette
contingence a connu un déploiement exponentiel ; d’où la diversité, elle
aussi exponentielle, des espèces vivantes (sauf extinction massive),
comme plus tard des cultures humaines (sauf l’uniformisation moderne)
. En
effet, dans la trajection S/P qui institue la réalité du vivant, P ne
cesse d’excéder l’identité de S. Certes, celui-ci le conditionne, mais
il ne peut pas le déterminer, parce que, non moins qu’il suppose
l’existence de S, P suppose celle du tiers terme qu’est le vivant qui «
prédique » S en tant que P. Ainsi, la réalité est toujours émergente :
ni répétable, ni réversible. Ce qui en elle est répétable ou réversible
n’est que son soubassement le plus brut, le plus physique, et en
définitive le plus mort.
Or c’est
bien le drame de la civilisation moderne que de s’être enclanchée sous
le signe du mécanique, et de vouloir y ramener toute réalité alors que
le déploiement même de l’univers – le déploiement de l’être – est allé, à
l’inverse, de la mécanique céleste vers la vie, et de là vers l’humain.
Prenant ce déploiement à rebours, une telle civilisation n’est pas
seulement anacosmique, c’est aussi un Sein zum Tode – un
être vers la mort ; et c’est bien cela qu’elle manifeste en
fonctionnant, dans l’histoire de la Terre, comme une sixième extinction
de masse des espèces vivantes.
Ce qui
est en jeu dans la biodiversité, ce n’est pas seulement le sort de telle
ou telle espèce, mais bien le sens moral d’une pareille civilisation.
Le réductionnisme mécaniciste idéalise en effet l’inverse de la morale :
la machine, qui ne juge rien. En revanche, comme l’écrivit Hölderlin, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch
(là ou est le danger, croît aussi ce qui sauve) : ce que nous appelons
aujourd’hui la crise de la biodiversité pourrait bien être l’occasion
d’assumer l’histoire naturelle qui nous a portés à devenir des êtres
moraux, et de ce fait investis du devoir moral de la respecter dans ce
qui l’incarne tout autant que nous-mêmes : les autres espèces, nos
semblables à l’égard de la vie.
Palaiseau, 12 décembre 2010
Références
- BERQUE, Augustin (1996) Être humains sur la Terre. Principes d’éthique de l’écoumène, Paris, Gallimard.
- Id. (2000) Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains. Paris, Belin.
- Id. (2010) Milieu et identité humaine. Notes pour un dépassement de la modernité. Paris, Donner lieu.
- DE WAAL, Frans (2008) Primates et philosophes, Paris, Le Pommier.
- MARIS Virginie (2010) Philosophie de la biodiversité. Petite éthique pour une nature en péril, Paris, Buchet-Chastel.
- TREMBLAY, Jacynthe (dir., 2010) Philosophes japonais contemporains, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- UEXKÜLL, Jacob von (1965) Mondes animaux et mondes humains, Paris, Denoël (Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, 1934).
- WATSUJI, Tetsurô (2010) Fûdo. Le milieu humain, Paris, Éditions du CNRS (風土, 1935).