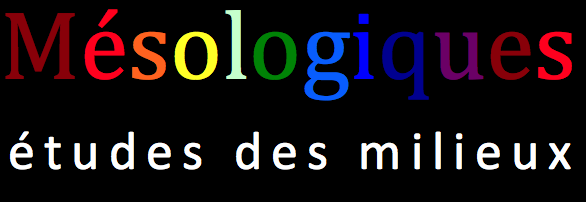Séminaire « Paysages culturels »
MNHN, UMR « Hommes, natures, sociétés » / IRD/PALOC
Amphithéâtre Rouelle, 47 rue Cuvier, 30/10/14, 17-19 h
Y a-t-il un pur apparaître du paysage ?
par Augustin BERQUE
 |
| (source) |
1. Il n’y aurait que le mont Jingting
衆鳥高飛盡 Zhòng niăo gāo fēi jìn Là haut passe un vol d’oiseaux
孤雲獨去閒 Gū yún dú qù xián Solitaire un nuage s’en va paisible
相看兩不厭 Xiāng kàn liăng bú yàn À se regarder l’un l’autre inlassables
只有敬亭山 Zhí yǒu Jìngtíngshān Il n’y a que le mont Jingting
Li Bai (701-762) nous laisse entendre que le poète et la montagne (le Jingting shan, « mont du Pavillon des Respects », dans l’Anhui), à se contempler mutuellement, ne seraient qu’un seul apparaître : le mont Jingting.
François Cheng, qui reproduit ce poème dans L’écriture poétique chinoise[1], en donne les deux traductions suivantes :
Multiples oiseaux haut s’envoler disparaître Les oiseaux s’envolent, disparaissent.
Solitaire nuage à part s’en aller oisif Un dernier nuage, oisif, se dissipe.
Se contempler à deux sans se lasser À se contempler indéfiniment l’un l’autre,
Ne plus rester que le mont Révérencieux Il ne reste que le mont Révérencieux.
Il commente ainsi le dernier vers : « C’est à dessein que nous avons traduit le dernier vers de façon ‘paradoxale’, alors que, pour le rendre compréhensible, il faudrait dire : ‘Il ne reste plus que le mont et moi’. Or, dans le texte chinois, ‘et moi’ est absent ; le poète semble signifier par là qu’à force de contempler le mont il finit par faire corps avec lui »[2]. C’est là bien entendu un commentaire à l’usage du lecteur francophone moyen, qui n’a aucune idée du milieu où un tel poème s’insère. Et dans la même intention, pour commencer, Cheng en traduit le titre par « Le mont Ching-t’ing »[3], ce qui est on ne peut plus accessible, mais esquive un problème de première grandeur en laissant de côté que le titre chinois Jìngtíng dú zuò peut s’entendre de deux façons : soit en considérant Jingting comme locatif, ce qui donne « Seul assis au (mont) Jingting », soit comme nominatif, ce qui donne « Le Jingting seul prend place ».
C’est au contraire justement ce problème, et sa manifestation par l’ensemble du poème, que nous poserons ici. Mais donnons-en d’abord un autre exemple, japonais celui-ci, un haïku de Fubasami Fusae (1914-2014)[4] :
初景色 Hatsu-geshiki Premier paysage
富士を大きく Fuji wo ookiku le Fuji en grand
母の里 haha no sato village de ma mère
Les deux poèmes[5] ont en commun l’apparaître d’une montagne : là le Jingting shan, ici le Fuji san. Un apparaître pur, semble-t-il, car ni dans l’un ni dans l’autre cas, il n’est question de quelqu’un qui regarderait la montagne. Ni « je », ni le moindre sujet d’un verbe « regarder ». Certes, un tel verbe est bien présent dans le quatrain chinois : kàn 看, mais ce verbe n’a pas de sujet. Il est seulement précédé de xiāng 相, qui signifie « réciproquement »[6]. Cela implique donc l’existence de deux êtres qui se regardent, mais la langue ne va pas au-delà de cette implication : aucun de ces deux êtres n’est explicitement posé comme sujet de kàn. Et même, dans le haïku de Fusae[7], il n’y a aucun verbe ; toutefois, un regard est impliqué par la particule wo, qui fait du Fuji un accusatif : l’objet d’un certain regard, dont le sujet n’est pas explicité. Autre implication, le mot haha (mère) ne pouvant être employé que par un locuteur qui parle de sa propre mère, ce locuteur est donc présent dans la scène, bien qu’aucun mot ne l’explicite.
Dans les deux poèmes, donc, il y a implicitement, mais non explicitement, présence d’un certain sujet : la personne qui, respectivement, regarde le mont Jingting ou le mont Fuji. Jouer sur de telles implications, sans préciser le sujet impliqué, c’est justement l’un des traits marquants de la poétique d’Asie orientale, qu’illustrent les deux genres ici représentés : lejuéjù 絶句 chinois, et le haiku 俳句 nippon. Faire l’économie du sujet, c’est laisser la part plus belle au phénomène lui-même, d’une part, et d’autre part inviter plus directement le lecteur (ou l’auditeur) à entrer dans la scène, donc à prendre part lui-même à ce pur apparaître. Intersubjectivement, et en deçà de la distinction sujet-objet.
François Cheng, à propos du poème de Li Bai, parle d’un « paradoxe », qui est l’absence de « moi ». Une telle caractéristique n’est évidemment paradoxale que par rapport à ladoxa qu’est, pour nous, l’expression de moi ou de je. Dans le monde du juéjù ou dans celui du haïku, en revanche, la doxa, c’est de ne pas exprimer cette présence, mais de seulement l’impliquer. L’on notera toutefois que Li Bai force le trait par le contraste, explicite cette fois, entre le troisième et le quatrième vers du quatrain. Dans le troisième, xiāng exprime la mutualité de deux regards – dualité accusée encore par liăng 兩, « deux » –, alors que le quatrième conclut qu’« il n’y a que le mont Jingting ». Il n’y aurait donc, tout seul, que le phénomène « Jingting », dans lequel se fondraient le regard du sujet humain et celui attribué à la montagne.
2. Qu’est-ce que la relation paysagère ?
Attribuer un regard à une montagne est-il absurde ? Indubitablement – au moins du point de vue qui gouverne notre civilisation, celui du dualisme. De ce point de vue-là, une montagne est un objet inanimé strictement incapable d’accomplir une action telle que de regarder. Le xiāng kàn 相看 de Li Bai ne peut donc être qu’une métaphore, une licence poétique. Toutefois, il est évident que Li Bai pose volontairement le problème, en faisant délibérément de la montagne un partenaire, qui plus est finalement le seul actant du phénomène en question : un paysage. Il va ainsi au delà du principe qu’avait posé Zong Bing (375-443) dans le premier traité de paysage de l’histoire humaine, son Introduction à la peinture de paysage (Huà shānshŭi xù畫山水序) :
至於山水、質有而趣靈 Zhì yú shānshŭi, zhì yǒu ér qù líng[8].
Quant au paysage, tout en ayant substance, il tend vers l’esprit.
En effet, Zong Bing considère ici qu’il y a bien dualité dans le paysage : d’une part la substance (zhì 質) propre des « monts et des eaux » (shānshŭi 山水, i.e. le paysage), autrement dit leur forme matérielle, d’autre part ce qu’il appelle « l’esprit » (líng 靈). Ne nous interrogeons pas sur ce líng[9], qui concentre tout un Zeitgeist ; contentons-nous de le considérer ici comme le pôle subjectif de la relation paysagère. Toujours est-il que Zong Bing le distingue de la forme matérielle du paysage. Entre les deux, il y a une « tension vers » (qù 趣), dont je dirai qu’elle n’est autre que l’apparaître du paysage. Cela même à quoi Li Bai, tout compte fait, résume la scène de son poème, en élaguant les deux termes de la relation abstraite voyant/vu pour n’en garder que la synthèse concrète : un pur phénomène, qu’il appelle « le mont Jingting ».
Le dualisme proprement dit considère deux termes dans la relation paysagère : un objet, avec sa substance propre ; et, avec sa substance non moins propre, un sujet portant son regard sur cet objet. Une version répandue de ce dualisme considérera même que le paysage, c’est l’objet en question, indépendamment de la présence ou de l’absence du sujet qui éventuellement le regarde. C’est de ce point de vue que la géographie moderne a pu, un certain temps, se considérer comme une « science du paysage » (Landschaftskunde), et qu’il peut aujourd’hui exister une « écologie du paysage ». Ce même dualisme est implicite dans la distinction courante – elle est adoptée notamment par l’UNESCO dans ses classements au patrimoine mondial – entre « paysage naturel » et « paysage culturel ». Ce point de vue réduit le paysage à l’environnement objectif, c’est-à-dire à la forme matérielle d’une portion de l’étendue terrestre. Il a été combattu, entre autres, par l’école du paysage de La Villette, qui s’incarna dans le DEA « Jardins, paysages, territoires » fondé par Bernard Lassus en 1991, et que poursuit actuellement son successeur, le laboratoire AMP (architecture, milieu, paysage). Lassus professait en effet que le paysage n’est pas l’environnement, et que, par conséquent, l’étude de paysage ne relève pas de l’écologie (même si elle ne doit pas l’ignorer), mais de ce domaine sui generis qu’on appelle généralement en français « paysagisme ».
Cette thèse – connue comme « la mouvance de La Villette[10] » - se fonde sur un argument imparable par le dualisme : alors qu’il y a toujours et partout environnement sur notre planète (et rien n’empêche d’étendre la notion à Mars, Jupiter etc.), le paysage est une notion qui n’a ni toujours ni partout existé. Elle est apparue en Europe à la Renaissance, et environ mille ans plus tôt en Chine[11]. Cela signifie que le paysage est bien une relation particulière entre le sujet et l’objet, relation qui s’est instaurée quelque part à un certain moment de l’histoire, et que le dualisme, par définition, ne peut pas saisir. Il la forclora donc, à la fois par ethnocentrisme et par anachronisme, pour nous faire accroire qu’il y a universellement paysage dès lors qu’on ouvre les yeux sur l’environnement. Pour la mouvance de La Villette, c’est faux. Le paysage n’est pas un objet universel, c’est une relation particulière à cet objet universel qu’est l’environnement.
Quelle est donc cette relation particulière ? Le premier à l’avoir envisagée comme telle est Zong Bing. On a vu qu’il l’appelait qù 趣, terme qui signifie « tendre vers ». L’étymologie de ce sinogramme趣 n’est pas sans intérêt : elle associe 走, « courir », et 取, « prendre » ; i.e. « courir pour prendre ». Ainsi, la substance matérielle du paysage courrait prendre le sens que lui donne l’esprit ; et cette « course vers », ce serait justement l’apparition du phénomène de paysage, son Erscheinung. Voilà qui évoque un concept central de la mésologie : la trajection.
3. L’assomption du donné environnemental en tant que paysage
La mésologie – l’étude des milieux[12] – existe depuis que le médecin Charles Robin (1821-1885) en a proposé le programme et du même coup l’appellation à la Société de Biologie, le 7 juin 1848[13] ; mais elle ne releva d’abord que du dualisme positiviste le plus strict (Robin était disciple d’Auguste Comte). C’est sur de tout autres bases, inspirées par la phénoménologie, qu’elle a été refondée sous le nom d’Umweltlehre par le naturaliste germano-balte Jakob von Uexküll (1864-1944), puis sous celui de fûdogaku 風土学 par le philosophe japonais Watsuji Tetsurô (1889-1960)[14]. Le premier a résumé ses vues en 1934 dans un petit livre intitulé Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen(Incursions dans les mondes d’animaux et d’humains)[15], le second a exposé les siennes en 1935 dans Fûdo. Ningengakuteki kôsatsu (Milieux. Études de l’entrelien humain)[16].
Uexküll, qui fut l’un des pères de l’éthologie, et le précurseur de la biosémiotique, a établi une distinction fondatrice entre, d’une part, le donné environnemental objectif (Umgebung), d’autre part le milieu (Umwelt) ; et Watsuji de même entre l’environnement naturel (shizen kankyô 自然環境) d’une part, le milieu (fûdo 風土) de l’autre. Pour les deux auteurs, alors que l’environnement est un donné universel, tel quel objectivable par la science moderne, le milieu n’existe comme tel qu’en fonction d’un certain sujet – une certaine espèce ou une certaine culture, un organisme ou une personne – qui lui-même n’existe qu’en fonction de son propre milieu. Watsuji nomme cette relation fûdosei 風土性, ce que j’ai traduit par médiance[17]. Il la définit comme « le moment structurel de l’existence humaine » (ningen sonzai no kôzô keiki 人間存在の構造契機)[18] ; ce qu’il faut entendre comme un couplage dynamique entre l’être et son milieu.
Uexküll, pour sa part, détaille les espèces sous lesquelles son propre milieu existe pour l’animal concerné ; espèces qu’il regroupe sous la catégorie de Ton, et dont il fait l’expression d’une « tonation » (Tönung). L’Umwelt se manifestera donc en tant que nourriture (Esston), abri (Schutzton), obstacle (Hinderniston), habitat (Wohnton), etc., toujours dépendamment de l’animal concerné. S’agissant des milieux humains, cette relation d’« en tant que » est ce que j’appelle l’en-tant-que écouménal (l’écoumène étant l’ensemble des milieux humains, ou la relation de l’humanité à l’étendue terrestre). Cet en-tant-que relève de quatre grandes catégories : ressources, contraintes, risques ou agréments, lesquelles se déclinent en une grande variété de prises médiales, dont l’une est par exemple l’en-tant-que-paysage, agrément qui est apparu comme on l’a vu au IVe siècle en Chine. Ces prises peuvent être rapprochées de ce que James Gibson, dans ce qu’il appelait « l’approche écologique de la perception visuelle »[19], a nommé affordances. Elles en ont en effet l’ambivalence, car elles ne relèvent proprement ni du seul objet, ni du seul sujet, mais bien de leur relation, laquelle est trajective.
La trajection qui donne naissance à ces prises est analogue à ce qu’on appelle prédication en logique. Le donné environnemental (l’Umgebung) y est en position de sujet logique (S, ce dont il s’agit), et les catégories de prises selon lesquelles on saisit S (par les sens, l’action, la pensée et la parole) y sont en position de prédicat (P). S est donc assumé en tant que P. Cette assomption de S en tant que P, ce n’est autre que la réalité pour l’être concerné. Ainsi, la réalité est trajective. Cela se représente par la formule de la trajection : r = S/P (ce qui se lit : la réalité, c’est S en tant que P). Dans le cas qui nous concerne, S (l’environnement) est assumé en tant que paysage (P) ; c’est la trajection paysagère.
4. La trajection paysagère comme cosmophanie
L’ontologie heideggérienne, qui doit beaucoup aux travaux d’Uexküll, a défini le monde (Welt) comme « manifesteté de l’étant » (Offenbarkeit des Seienden)[20], manifesteté qui relève d’un « être-ouvert prélogique » (vorlogische Offensein)[21]. On n’hésitera pas à reconnaître là (il s’agit du séminaire professé par Heidegger au semestre d’hiver 1929/30) la marque de la Tönung selon Uexküll, laquelle fait exister les données de l’Umgebung en tant que les divers « tons » de l’Umwelt qui est propre à un certain animal. Heidegger écrit cependant :
Le comportement de l’animal n’est jamais une perception de quelque chose en tant que quelque chose. Dans la mesure où nous considérons cette possibilité de prendre quelque chose en tant que quelque chose (etwas als etwas) comme une caractéristique du phénomène de monde (des Weltphänomens), la structure d’« en tant que » (die ›als‹-Struktur) est une détermination essentielle de la structure de monde[22].
et corrélativement, il déniera à l’animal l’accès à l’étant (c’est-à-dire à l’être concret, celui qui existe : das Seiende) :
Dans toute activité de son comportement, l’animal est absorbé (hingenommen) par cela même avec quoi il est mis en relation (worauf es bezogen ist) dans ce comportement. Ce avec quoi il est en relation ne lui est donc jamais, dans son « être-quoi », donné en tant que tel ; cela ne lui est pas donné comme ce que c’est et comment c’est ; cela ne lui est pas donné en tant qu’étant (nicht als Seiendes)[23].
Du point de vue de la mésologie, c’est là une naïveté anthropocentrique. Pour tout être vivant, il est indubitable – car prouvé scientifiquement depuis Uexküll – que son milieu existe en tant que la réalité qui lui est propre : celle de son Umwelt, qui est cela même « avec quoi il est mis en relation ». Que cette réalité ne soit pas celle du milieu qui est le nôtre, cela va de soi. La nôtre est humaine, la sienne est propre à son espèce ; mais dans tous les cas, elles sont constituées des étants propres à un certain monde, lesquels apparaissent nécessairement en tant que quelque chose à l’être concerné. Certes, les étants constitutifs du milieu d’une tique[24], ontologiquement, ne sont pas du même niveau que cet étant qu’est pour nous le paysage, de même que la biosphère n’est ontologiquement pas du même niveau que l’écoumène ; car la biosphère est seulement écologique, tandis que l’écoumène, combinant aux écosystèmes les systèmes techniques et symboliques propres à l’humanité, est éco-techno-symbolique. Néanmoins, tous ces divers étants naissent d’un même processus trajectif : la cosmophanie en vertu de laquelle le donné environnemental apparaît en tant qu’un certain monde pour un certain être. Et du reste – à moins de réduire l’humain au seul logos[25] –, comme le prouvent l’éthologie et la biosémiotique, il n’y a pas de frontière nette entre la biosphère et l’écoumène ; toutes deux sont nées par trajection à partir de ce substrat qu’est la planète (d’abord la biosphère, et bien plus tard l’écoumène à partir de celle-ci).
Ce processus, Heidegger l’avait pourtant saisi comme ce qu’il appelle « als-Struktur » (structure d’en tant que). Si toutefois il amorce ainsi un rapprochement avec la logique, il ne va pas jusqu’à préciser de quelle logique il s’agirait là. En effet, malgré ses nombreux contacts avec des philosophes japonais, il n’a pas introduit clairement dans son ontologie du « phénomène de monde » un apport qui aurait certainement rendu son propos moins abscons – notamment dans L’Origine de l’œuvre d’art, où il parle d’un obscur « litige » (Streit) entre terre et monde[26] – ; à savoir la « logique du prédicat » (jutsugo no ronri 述語の論理) selon Nishida Kitarô (1870-1945)[27], lequel, avec autour de lui l’école dite de Kyôto, tenait à l’époque le haut du pavé métaphysique au Japon.
Dans cette logique du prédicat que Nishida, notamment dans Basho (Lieu, 1926), opposait à la logique aristotélicienne de l’identité du sujet (S), le monde est considéré comme un prédicat : le « monde prédicatif » (jutsugo sekai 述語世界). Nakamura Yûjirô[28] a plus tard rapproché[29] la logique du prédicat nishidienne de la « paléologique » (palaeologic) dont Silvano Arieti parle dans son Interpretation of schizophrenia[30]. Sans entrer dans l’argumentation de Nishida lui-même[31], qui relève d’une mystique du néant dérivée du zen plutôt que de la logique, la mésologie en retient cette idée lumineuse : le monde est un prédicat.
Dans sa cosmophanie, en effet, le monde est l’ensemble des prédicats (P) sous le jour desquels – en tant que quoi – nous apparaît la Terre qui nous porte, et qui est là en position de S : ce substrat que les Grecs ont appelé « ce qui gît dessous » (hupokeimenon ὑποκείμενον) ou « se-tenir-dessous » (hupostasis ὑπόστασις), et que les Romains ont rendu parsubjectum et substantia. Sujet : substance : substrat : S : cela qu’un certain être assume en tant que quelque prédicat (P), dans la relation trajective qu’est un certain milieu (S/P). Et parmi ces prédicats, tous historiques et contingents par rapport à S, il en est un que les Chinois, au IVe siècle, ont nommé « paysage » (shānshŭi).
5. La naissance du paysage
Précisons. Le mot shānshŭi n’est pas apparu au IVe siècle, il est plus ancien ; mais c’est au IVe siècle qu’il a indubitablement pris le sens de paysage, autrement dit que le substrat « monts et eaux » (S) a été assumé en tant que paysage (P). Comment s’est déroulée cette trajection ? Cela se passa en Chine du sud, à l’époque des Six Dynasties (IIIe-VIe siècle) [32]. Cette période fait suite à celle des Trois Royaumes (IIIe siècle), qui elle-même faisait suite à l’écroulement de l’empire Han (contemporain de l’Empire romain). Dans ce temps d’invasions barbares et de guerres incessantes, la dynastie Jin se réfugie au sud du Yangzi, où les élites de la culture chinoise vont découvrir un milieu beaucoup plus accidenté – des paysages pittoresques, dirions-nous – que celui des grandes plaines de la Chine du nord. Ils ouvrent les yeux sur un monde nouveau. En même temps, les troubles dynastiques font que la carrière de mandarin devient risquée. Beaucoup, par désaccord avec le régime ou simplement pour sauver leur peau, quittent la capitale et se réfugient sur leurs terres. C’est aussi l’époque où le confucianisme, qui avait soutenu l’empire Han et qui exalte la règle sociale, connaît une relative éclipse devant le taoïsme, lequel au contraire exalte la nature. Dans cette conjoncture, le talent littéraire de ces lettrés que sont les mandarins construira un mythe homologue au mythe arcadien en Europe, celui de l’ermitage paysager.
C’est en effet de ces circonstances que « le paysage » est né. Il a fallu d’abord, bien sûr, un mot pour le dire. Ce mot existait déjà depuis longtemps, mais il n’avait pas le sens de « paysage ». Il signifiait « les eaux de la montagne », shānshŭi 山水. C’était un mot que, depuis le temps des Royaumes combattants (Ve-IIIe siècle av. J.-C.), utilisaient les ingénieurs hydrauliciens, qui désignaient par là les torrents montagnards qu’ils devaient maîtriser pour protéger les maisons ou pour l’irrigation. Aucune connotation esthétique, comme en témoigne le fait que ce mot n’était pas utilisé en poésie. Il ne le sera esthétiquement pour la première fois que beaucoup plus tard, vers 300, dans un poème de Zuo Si, intitulé « Visite à l’ermite », où il signifie encore « les eaux de la montagne », mais cela pour dire qu’on y trouve un plaisir esthétique : « les eaux de la montagne ont un son pur » (shānshŭi yǒu qīng yīn山水有清音).
Puis ce nouveau sens de shānshŭi va s’étendre à la vue. Ce sera chose faite à la fameuse réunion du Pavillon des orchidées (Lanting), chez le grand calligraphe Wang Xizhi, le 3ejour du 3e mois de 353. Cette date est celle d’un rite de lustration très ancien, où l’on allait au bord des rivières se laver des souillures de l’an écoulé. Puis ce rite était devenu, dans les classes cultivées, l’occasion d’une fête où l’on se réunissait dans un jardin, agrémenté d’un ruisseau, et où l’on festoyait en composant des distiques. Il s’agissait de terminer le poème avant qu’une coupe de vin, flottant sur le ruisseau, n’arrive à votre hauteur. Dans la quarantaine de poèmes qui nous sont restés du banquet de Lanting, plusieurs comportent le mot shānshŭi dans l’acception évidente de « paysage ». Par exemple, de Wang Huizhi[33] :
散懐山水 Sàn huái shānshŭi Distrayant mon cœur dans le paysage
蕭然忘羈 Xiāorán wàng jī À moi-même absent, j’oublie mon licou
ou encore, de Sun Tong :
地主観山水 Dìzhŭ guān shānshŭi Le maître de céans scrute le paysage
仰尋幽人踪 Yăng xún yōu rén zōng Vers les hauteurs cherchant traces d’anachorètes
où l’on voit aussi clairement que le paysage ne relève pas de la dimension mondaine ordinaire, ce « licou » dont parle le premier distique. Effectivement, pour naître, le paysage a exigé qu’une certaine fraction de la bonne société rejetât la ville et jouât les anachorètes ; c’est le mouvement érémitique dont cette leisure class a construit la légende. Nous lui devons le prédicat « paysage », dont elle a même pressenti la trajection ; ainsi dans ces vers de Xie Lingyun (385-433), que je considère comme l’acte de naissance du paysage :
情用賞為美 Qíng yòng shăng wéi mĕi Le sentiment, par le goût, fait la beauté
事昧竟誰辨 Shì mèi jìng shéi biàn Chose obscure avant qu’on la dise
観此遺物慮 Guān cĭ yí wù lῢ Oubliant à sa vue les soucis mondains
一悟得所遣 Yì wŭ dé sŭo qiăn L’ayant saisie, on peut s’y livrer[34]
Et désormais, oui, d’avoir saisi l’environnement (S) en tant que paysage (P), l’on a pu se livrer à la beauté du paysage comme tel[35].
6. Le prédicat « paysage » est-il vraiment un pur apparaître ?
Entendons-nous. La réalité de S en tant que P – l’environnement en tant que paysage, S/P –, c’est bien la réalité tout court pour l’être concerné, telle que, dans la « tension vers » dont parlait Zong Bing, elle existe – elle ek-siste – pour cet être. Ek-siste hors de quoi ? Hors de la gangue de l’identité de S pour devenir S/P, faute de quoi justement elle n’existerait pas. Ne serait-ce là qu’un jeu de mots ? Non. Cette extraction – cette ek-sistance – de la réalité des étants hors du donné environnemental brut (l’Umgebung), lequel en soi n’est pas perceptible, elle est aujourd’hui prouvée et même quantifiée par la science. Témoin ce passage, que j’extrais d’une revue de sciences cognitives :
Thus, of the unlimited information available from the environment, only about 1010 bits/sec are deposited in the retina. Because of a limited number of axons in the optic nerves (approximately 1 million axons in each) only_6x106 bits/sec leave the retina and only 104 make it to layer IV of V1. These data clearly leave the impression that the visual cortex receives an impoverished representation of the world, a subject of more than passing interest to those interested in the processing of visual information. Parenthetically, it should be noted that estimates of the bandwidth of conscious awareness itself (i.e. what we ‘see’) are in the range of 100 bits/sec or less[36].
Traduisons en termes appropriés à la question du paysage, à savoir en termes de mésologie : « the environment », c’est S : ce donné environnemental brut qu’est l’Umgebung ; et « the processing of visual information », c’est la trajection qui va donner du sens à S, en l’assumant en tant que P : « what we ‘see’ », en l’occurrence du paysage. Sans cette trajection, ni S ni P n’existeraient pour nous : c’est bien dans la trajection S/P qu’il y a paysage, autrement dit la réalité. Or on voit que cette réalité s’établit dans une sélection drastique de l’information contenue dans S ; et que c’est de par cette sélection même que l’information, qui en soi ne signifie rien, devient significative. Autrement dit, qu’elle devient un paysage, composé concrètement des étants de notre milieu (S/P).
Alors, peut-on considérer cette trajection – ce qù 趣 par lequel la substance de l’environnement court devenir un paysage – comme un « pur » apparaître ? Apparemment non ; mais à bien y regarder... C’est une élaboration qui a commencé, au bas mot, il y a 3,8 milliards d’années, quand les premiers êtres vivants se sont différenciés de leur environnement (S) pour le saisir en tant que quelque chose (P) qui n’était pas eux-mêmes. Depuis, cette trajection n’a cessé de se poursuivre, de se complexifier, d’émerger, d’ek-sister en niveaux ontologiques de moins en moins réductibles à la seule identité de S. Et pourtant, tout cela se tient unitairement ! C’est dire que, dans cette poétique de la Terre[37], il y a place pour le seul mont Jingting, non moins que pour son décompte en milliards de bits/sec.
Palaiseau, 25 octobre 2014.
[1] Paris, Seuil, 1977, p. 128.
[2] Ibid., note 1.
[3] Cheng utilise encore la transcription Wade-Giles, tandis que j’utilise la transcription pinyin, aujourd’hui normale. De même, il écrit Li Bo au lieu de Li Bai.
[4] Cité par YAMAMOTO Kenkichi, Shin haiku saijiki (Nouveau saisonnier du haïku), Tokyo, Bungei shunju, 1977, vol. V, p. 23.
[5] J’ai commenté plus en détail le premier dans Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000, p. 50 sqq, et le second dans Le sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature, Paris, Gallimard, 1986, p. 221 sqq.
[6] Ce caractère 相 comporte deux éléments, à gauche un arbre et à droite un œil. Il signifie étymologiquement que quelqu’un regarde un arbre. D’où l’idée que A et B sont en vis-à-vis, et s’observent mutuellement.
[7] Comme auteur de haïku, celle-ci est connue par son prénom.
[8] On trouvera le texte chinois complet, avec traduction et commentaires, dans Hubert DELAHAYE, Les Premières peintures de paysage en Chine, aspects religieux, Paris, École française d’Extrême-Orient, 1981.
[9] On en trouvera une minutieuse analyse dans Delahaye, op. cit.
[10] Laquelle s’est manifestée comme telle au moins dans trois ouvrages collectifs : A. BERQUE (dir.) Cinq propositions pour une théorie du paysage, Seyssel, Champ Vallon, 1994; Id., La Mouvance. Du jardin au territoire, cinquante mots pour le paysage, Paris, Éditions de la Villette, 1999 ; Id., Mouvance II. Du jardin au territoire, soixante-dix mots pour le paysage. Paris, Éditions de la Villette, 2006.
[11] On en a la preuve écrite à partir de 353. Sur cette apparition, v. mon Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient vers l’Occident, Paris, Le Félin, 2010 ; et plus spécifiquement mon Thinking through landscape, Abingdon, Routledge, 2013.
[12] V. mon La mésologie, pourquoi et pour quoi faire, Nanterre La Défense, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014.
[13] Georges CANGUILHEM, Études d’histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, Paris, Vrin, 1968, p. 71.
[14] Le patronyme est Watsuji.
[15] Réédité en 1956 par Rowohlt, Hambourg ; traduit une première fois sous le titre Mondes animaux et monde humain, Paris, Denoël, 1965 ; une seconde fois comme Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot & Rivages, 2010.
[16] Tokyo, Iwanami. Traduit sous le titre Fûdo. Le milieu humain, Paris, CNRS, 2011.
[17] Dans Le sauvage et l’artifice, op. cit. ; voir également mon Médiance, de milieu en paysage, Paris, Belin/RECLUS, 1990.
[18] P. 35 dans l’édition française.
[19] James GIBSON, The ecological approach to visual perception, Boston, Houghton & Mifflin, 1979.
[20] Martin HEIDEGGER, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt–Endlichkeit-Einsamkeit (Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde-finitude-solitude), Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1983, p. 409.
[21] Op. cit., p. 498.
[22] Op. cit., p. 450.
[23] Ibid.
[24] L’animal de prédilection des travaux d’Uexküll.
[25] Illusion que, si besoin était, balaient George LAKOFF et Mark JOHNSON, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, New York, Basic Books, 1999.
[26] Pour la mésologie, ce « litige » n’est autre que la trajection S/P (terre/monde).
[27] Le patronyme est Nishida. La « logique du prédicat » était également appelée « logique du lieu » (basho no ronri 場所の論理).
[28] Le patronyme est Nakamura.
[29] Dans Nishida Kitarô, Tokyo, Iwanami, 1983, p. 104 sqq.
[30] New York, Brunner, 1955. Arieti a montré que cette paléologique est fondée sur l’identité du prédicat. Exemple : le pseudo-syllogisme « 1. Napoléon portait un bicorne ; 2. or je porte un bicorne ; 3. donc je suis Napoléon » (cf. l’asile où séjourne Tintin dans Les cigares du pharaon). En dehors des asiles de fous, cette paléologique est non seulement à l’œuvre dans le rêve, la métaphore, le mythe, mais également dans tous les comportements imitatifs sur lesquels table entre autres la pub, et dont l’une des sources est dans nos « neurones miroirs ». C’est proprement une logique mondaine, comme l’a bien exprimé Nishida en parlant de « monde prédicatif ».
[31] Que j’ai critiquée dans « La logique du lieu dépasse-t-elle la modernité ? », p. 41-52, et dans « Du prédicat sans base : entre mundus et baburu, la modernité », p. 53-62 dans Livia MONNET (dir.) Approches critiques de la pensée japonaise au XXe siècle, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2002.
[32] Pour plus de détails, v. Thinking through landscape, op. cit.
[33] Ce poème et le suivant sont cités par GOTÔ Akinobu et MATSUMOTO Hajime (dir.), Shigo no imêji. Tôshi wo yomu tame ni (Les Images du vocabulaire poétique. Pour lire la poésie Tang), Tokyo, Tôhô shoten, 2000, p. 81 sq.
[34] Ce sont les derniers vers d’un long poème, Par crêtes et vaux à partir de Jinzhujian. Jinzhujian (le gave de Jinzhu) est près de Shaoxing, dans les monts Guiji, où Xie Lingyun s’est retiré dans sa luxueuse villa de Shining. Cité par OBI Kôichi, Sha Reiun, kodoku no sansui shijin (Xie Lingyun, le poète solitaire du paysage), Tokyo, Kyûko shoin, 1983, p. 179. Je commente plus longuement ce poème dans Histoire de l’habitat idéal, op. cit., p. 102 sqq.
[35] Je ne reviens pas ici sur les sept critères qui permettent d’assurer que les Romains ne possédaient pas la notion de paysage. Sur ce thème, v. Thinking through landscape, op. cit.
[36] Marcus E. RAICHLE, “Two views of brain function”, Trends in cognitive sciences, XIV (2010), 4, 180-190, p. 181.
[37] Thème de mon Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie, Paris, Belin, 2014.